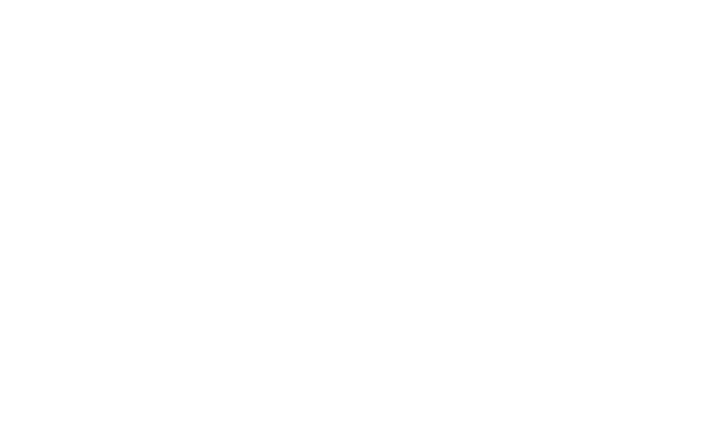|
| | Contes et poêmes sur le thème de l'hiver |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Jeu 3 Nov - 19:55 Jeu 3 Nov - 19:55 | |
| Aujourd'hui, la première neige est tombée sur Québec  :frette: Pour souligner l'occasion, je vous propose un poême de Nelligan, un grand poête québecois. Ah comme la neige a neigé
Émile Nelligan
Ah comme la neige a neigé
Ma vitre est un jardin de givre
Ah comme la neige a neigé
Qu'est-ce que le spasme de vivre
Ah la douleur que j'ai que j'ai!
Tous les étangs gisent gelés
Mon âme est noire où vis-je où vais-je
Tous mes espoirs gisent gelés
Je suis la nouvelle Norvège
D'où les blonds ciels s'en sont allés.
Pleurez oiseaux de février
Au sinistre frisson des choses
Pleurez oiseaux de février
Pleurez mes pleurs pleurez mes roses
Aux branches du genévrier.
Ah comme la neige a neigé
Ma vitre est un jardin de givre
Ah comme la neige a neigé
Qu'est-ce que le spasme de vivre
Ah tout l'ennui que j'ai que j'ai.Pour en connaître plus sur Émile Nelligan : http://www.emile-nelligan.com/biographie.htmlPS, moi ça me déprime pas la neige mais j'aime quand même ce poême
Dernière édition par le Ven 25 Nov - 12:09, édité 1 fois | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Jeu 3 Nov - 19:57 Jeu 3 Nov - 19:57 | |
| Et tant qu'à y être, je vous mets mon conte préféré
LA REINE DES NEIGES
UN CONTE EN SEPT HISTOIRES
Hans Christian Andersen
PREMIERE HISTOIRE
QUI TRAITE D'UN MIROIR ET DE SES MORCEAUX
Voilà ! Nous commençons. Lorsque nous serons à la fin de l'histoire, nous en saurons plus que maintenant, car c'était un bien méchant sorcier, un des plus mauvais, le «diable» en personne.
Un jour il était de fort bonne humeur : il avait fabriqué un miroir dont la particularité était que le Bien et le Beau en se réfléchissant en lui se réduisaient à presque rien, mais que tout ce qui ne valait rien, tout ce qui était mauvais, apparaissait nettement et empirait encore. Les plus beaux paysages y devenaient des épinards cuits et les plus jolies personnes y semblaient laides à faire peur, ou bien elles se tenaient sur la tête et n'avaient pas de ventre, les visages étaient si déformés qu'ils n'étaient pas reconnaissables, et si l'on avait une tache de rousseur, c'est toute la figure (le nez, la bouche) qui était criblée de son. Le diable trouvait ça très amusant.
Lorsqu'une pensée bonne et pieuse passait dans le cerveau d'un homme, la glace ricanait et le sorcier riait de sa prodigieuse invention.
Tous ceux qui allaient à l'école des sorciers - car il avait créé une école de sorciers - racontaient à la ronde que c'est un miracle qu'il avait accompli là. Pour la première fois, disaient-ils, on voyait comment la terre et les êtres humains sont réellement. Ils couraient de tous côtés avec leur miroir et bientôt il n'y eut pas un pays, pas une personne qui n'eussent été déformés là-dedans.
Alors, ces apprentis sorciers voulurent voler vers le ciel lui-même, pour se moquer aussi des anges et de Notre-Seigneur. Plus ils volaient haut avec le miroir, plus ils ricanaient. C'est à peine s'ils pouvaient le tenir et ils volaient de plus en plus haut, de plus en plus près de Dieu et des anges, alors le miroir se mit à trembler si fort dans leurs mains qu'il leur échappa et tomba dans une chute vertigineuse sur la terre où il se brisa en mille morceaux, que dis-je, en des millions, des milliards de morceaux, et alors, ce miroir devint encore plus dangereux qu'auparavant. Certains morceaux n'étant pas plus grands qu'un grain de sable voltigeaient à travers le monde et si par malheur quelqu'un les recevait dans l'œil, le pauvre accidenté voyait les choses tout de travers ou bien ne voyait que ce qu'il y avait de mauvais en chaque chose, le plus petit morceau du miroir ayant conservé le même pouvoir que le miroir tout entier. Quelques personnes eurent même la malchance qu'un petit éclat leur sautât dans le cœur et, alors, c'était affreux : leur cœur devenait un bloc de glace. D'autres morceaux étaient, au contraire, si grands qu'on les employait pour faire des vitres, et il n'était pas bon dans ce cas de regarder ses amis à travers elles. D'autres petits bouts servirent à faire des lunettes, alors tout allait encore plus mal. Si quelqu'un les mettait pour bien voir et juger d'une chose en toute équité, le Malin riait à s'en faire éclater le ventre, ce qui le chatouillait agréablement.
Mais ce n'était pas fini comme ça. Dans l'air volaient encore quelques parcelles du miroir !
Ecoutez plutôt.
DEUXIEME HISTOIRE
UN PETIT GARÇON ET UNE PETITE FILLE
Dans une grande ville où il y a tant de maisons et tant de monde qu'il ne reste pas assez de place pour que chaque famille puisse avoir son petit jardin, deux enfants pauvres avaient un petit jardin. Ils n'étaient pas frère et sœur, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Leurs parents habitaient juste en face les uns des autres, là où le toit d'une maison touchait presque le toit de l'autre, séparés seulement par les gouttières. Une petite fenêtre s'ouvrait dans chaque maison, il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'un logement à l'autre. Les familles avaient chacune devant sa fenêtre une grande caisse où poussaient des herbes potagères dont elles se servaient dans la cuisine, et dans chaque caisse poussait aussi un rosier qui se développait admirablement. Un jour, les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières de sorte qu'elles se rejoignaient presque d'une fenêtre à l'autre et formaient un jardin miniature. Les tiges de pois pendaient autour des caisses et les branches des rosiers grimpaient autour des fenêtres, se penchaient les unes vers les autres, un vrai petit arc de triomphe de verdure et de fleurs. Comme les caisses étaient placées très haut, les enfants savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y grimper seuls, mais on leur permettait souvent d'aller l'un vers l'autre, de s'asseoir chacun sur leur petit tabouret sous les roses, et ils ne jouaient nulle part mieux que là. L'hiver, ce plaisir-là était fini. Les vitres étaient couvertes de givre, mais alors chaque enfant faisait chauffer sur le poêle une pièce de cuivre et la plaçait un instant sur la vitre gelée. Il se formait un petit trou tout rond à travers lequel épiait à chaque fenêtre un petit œil très doux, celui du petit garçon d'un côté, celui de la petite fille de l'autre. Lui s'appelait Kay et elle Gerda.
L'été, ils pouvaient d'un bond venir l'un chez l'autre ; l'hiver il fallait d'abord descendre les nombreux étages d'un côté et les remonter ensuite de l'autre. Dehors, la neige tourbillonnait.
- Ce sont les abeilles blanches qui papillonnent, disait la grand-mère.
- Est-ce qu'elles ont aussi une reine ? demanda le petit garçon.
- Mais bien sûr, dit grand-mère. Elle vole là où les abeilles sont les plus serrées, c'est la plus grande de toutes et elle ne reste jamais sur la terre, elle remonte dans les nuages noirs.
- Nous avons vu ça bien souvent, dirent les enfants.
Et ainsi ils surent que c'était vrai.
- Est-ce que la Reine des Neiges peut entrer ici ? demanda la petite fille.
- Elle n'a qu'à venir, dit le petit garçon, je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra aussitôt.
Le soir, le petit Kay, à moitié déshabillé, grimpa sur une chaise près de la fenêtre et regarda par le trou d'observation. Quelques flocons de neige tombaient au-dehors et l'un de ceux-ci, le plus grand, atterrit sur le rebord d'une des caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue du plus fin voile blanc fait de millions de flocons en forme d'étoiles. Elle était belle, si belle, faite de glace aveuglante et scintillante et cependant vivante. Ses yeux étincelaient comme deux étoiles, mais il n'y avait en eux ni calme ni repos. Elle fit vers la fenêtre un signe de la tête et de la main. Le petit garçon, tout effrayé, sauta à bas de la chaise, il lui sembla alors qu'un grand oiseau, au- dehors, passait en plein vol devant la fenêtre.
Le lendemain fut un jour de froid clair, puis vint le dégel et le printemps.
Cet été-là les roses fleurirent magnifiquement, Gerda avait appris un psaume où l'on parlait des roses, cela lui faisait penser à ses propres roses et elle chanta cet air au petit garçon qui lui-même chanta avec elle :
Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler.
Les deux enfants se tenaient par la main, ils baisaient les roses, admiraient les clairs rayons du soleil de Dieu et leur parlaient comme si Jésus était là. Quels beaux jours d'été où il était si agréable d'être dehors sous les frais rosiers qui semblaient ne vouloir jamais cesser de donner des fleurs !
Kay et Gerda étaient assis à regarder le livre d'images plein de bêtes et d'oiseaux - l'horloge sonnait cinq heures à la tour de l'église - quand brusquement Kay s'écria :
- Aïe, quelque chose m'a piqué au cœur et une poussière m'est entrée dans l'œil. La petite le prit par le cou, il cligna des yeux, non, on ne voyait rien.
- Je crois que c'est parti, dit-il.
Mais ce ne l'était pas du tout ! C'était un de ces éclats du miroir ensorcelé dont nous nous souvenons, cet affreux miroir qui faisait que tout ce qui était grand et beau, réfléchi en lui, devenait petit et laid, tandis que le mal et le vil, le défaut de la moindre chose prenait une importance et une netteté accrues.
Le pauvre Kay avait aussi reçu un éclat juste dans le cœur qui serait bientôt froid comme un bloc de glace. Il ne sentait aucune douleur, mais le mal était fait.
- Pourquoi pleures-tu ? cria-t-il, tu es laide quand tu pleures, est-ce que je me plains de quelque chose ? Oh! cette rose est dévorée par un ver et regarde celle-là qui pousse tout de travers, au fond ces roses sont très laides.
Il donnait des coups de pied dans la caisse et arrachait les roses.
- Kay, qu'est-ce que tu fais ? cria la petite.
Et lorsqu'il vit son effroi, il arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre, laissant là la charmante petite Gerda.
Quand par la suite elle apportait le livre d'images, il déclarait qu'il était tout juste bon pour les bébés et si grand-mère gentiment racontait des histoires, il avait toujours à redire, parfois il marchait derrière elle, mettait des lunettes et imitait, à la perfection du reste, sa manière de parler ; les gens en riaient.
Bientôt il commença à parler et à marcher comme tous les gens de sa rue pour se moquer d'eux.
On se mit à dire : « Il est intelligent ce garçon-là ! » Mais c'était la poussière du miroir qu'il avait reçue dans l'œil, l'éclat qui s'était fiché dans son cœur qui étaient la cause de sa transformation et de ce qu'il taquinait la petite Gerda, laquelle l'aimait de toute son âme.
Ses jeux changèrent complètement, ils devinrent beaucoup plus réfléchis. Un jour d'hiver, comme la neige tourbillonnait au-dehors, il apporta une grande loupe, étala sa veste bleue et laissa la neige tomber dessus.
- Regarde dans la loupe, Gerda, dit-il.
Chaque flocon devenait immense et ressemblait à une fleur splendide ou à une étoile à dix côtés.
- Comme c'est curieux, bien plus intéressant qu'une véritable fleur, ici il n'y a aucun défaut, ce seraient des fleurs parfaites - si elles ne fondaient pas.
Peu après Kay arriva portant de gros gants, il avait son traîneau sur le dos, il cria aux oreilles de Gerda :
- J'ai la permission de faire du traîneau sur la grande place où les autres jouent ! Et le voilà parti.
Sur la place, les garçons les plus hardis attachaient souvent leur traîneau à la voiture d'un paysan et se faisaient ainsi traîner un bon bout de chemin. C'était très amusant. Au milieu du jeu ce jour-là arriva un grand traîneau peint en blanc dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure blanc avec un bonnet blanc également. Ce traîneau fit deux fois le tour de la place et Kay put y accrocher rapidement son petit traîneau.
Dans la rue suivante, ils allaient de plus en plus vite. La personne qui conduisait tournait la tète, faisait un signe amical à Kay comme si elle le connaissait. Chaque fois que Kay voulait détacher son petit traîneau, cette personne faisait un signe et Kay ne bougeait plus ; ils furent bientôt aux portes de la ville, les dépassèrent même.
Alors la neige se mit à tomber si fort que le petit garçon ne voyait plus rien devant lui, dans cette course folle, il saisit la corde qui l'attachait au grand traîneau pour se dégager, mais rien n'y fit. Son petit traîneau était solidement fixé et menait un train d'enfer derrière le grand. Alors il se mit à crier très fort mais personne ne l'entendit, la neige le cinglait, le traîneau volait, parfois il faisait un bond comme s'il sautait par-dessus des fossés et des mottes de terre. Kay était épouvanté, il voulait dire sa prière et seule sa table de multiplication lui venait à l'esprit.
Les flocons de neige devenaient de plus en plus grands, à la fin on eût dit de véritables maisons blanches ; le grand traîneau fit un écart puis s'arrêta et la personne qui le conduisait se leva, son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige et elle était une dame si grande et si mince, étincelante : la Reine des Neiges.
- Nous en avons fait du chemin, dit-elle, mais tu es glacé, viens dans ma peau d'ours.
Elle le prit près d'elle dans le grand traîneau, l'enveloppa du manteau. Il semblait à l'enfant tomber dans des gouffres de neige.
- As-tu encore froid ? demanda-t-elle en l'embrassant sur le front.
Son baiser était plus glacé que la glace et lui pénétra jusqu'au cœur déjà à demi glacé. Il crut mourir, un instant seulement, après il se sentit bien, il ne remarquait plus le froid.
«Mon traîneau, n'oublie pas mon traîneau.» C'est la dernière chose dont se souvint le petit garçon.
Le traîneau fut attaché à une poule blanche qui vola derrière eux en le portant sur son dos. La Reine des Neiges posa encore une fois un baiser sur le front de Kay, alors il sombra dans l'oubli total, il avait oublié Gerda, la grand-mère et tout le monde à la maison.
- Tu n'auras pas d'autre baiser, dit-elle, car tu en mourrais.
Kay la regarda. Qu'elle était belle, il ne pouvait s'imaginer visage plus intelligent, plus charmant, elle ne lui semblait plus du tout de glace comme le jour où il l'avait aperçue de la fenêtre et où elle lui avait fait des signes d'amitié ! A ses yeux elle était aujourd'hui la perfection, il n'avait plus du tout peur, il lui raconta qu'il savait calculer de tête, même avec des chiffres décimaux, qu'il connaissait la superficie du pays et le nombre de ses habitants. Elle lui souriait ... Alors il sembla à l'enfant qu'il ne savait au fond que peu de chose et ses yeux s'élevèrent vers l'immensité de l'espace. La reine l'entraînait de plus en plus haut. Ils volèrent par-dessus les forêts et les océans, les jardins et les pays. Au-dessous d'eux le vent glacé sifflait, les loups hurlaient, la neige étincelait, les corbeaux croassaient, mais tout en haut brillait la lune, si grande et si claire. Au matin, il dormait aux pieds de la Reine des Neiges. | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Jeu 3 Nov - 20:00 Jeu 3 Nov - 20:00 | |
| TROISIEME HISTOIRE
LE JARDIN DE LA MAGICIENNE
Mais que disait la petite Gerda, maintenant que Kay n'était plus là ? Où était-il ? Personne ne le savait, personne ne pouvait expliquer sa disparition. Les garçons savaient seulement qu'ils l'avaient vu attacher son petit traîneau à un autre, très grand, qui avait tourné dans la rue et était sorti de la ville. Nul ne savait où il était, on versa des larmes, la petite Gerda pleura beaucoup et longtemps, ensuite on dit qu'il était mort, qu'il était tombé dans la rivière coulant près de la ville. Les jours de cet hiver-là furent longs et sombres.
Enfin vint le printemps et le soleil.
- Kay est mort et disparu, disait la petite Gerda.
- Nous ne le croyons pas, répondaient les rayons du soleil.
- Il est mort et disparu, dit-elle aux hirondelles.
- Nous ne le croyons pas, répondaient-elles.
A la fin la petite Gerda ne le croyait pas non plus.
- Je vais mettre mes nouveaux souliers rouges, dit-elle un matin, ceux que Kay n'a jamais vus et je vais aller jusqu'à la rivière l'interroger.
Il était de bonne heure, elle embrassa sa grand-mère qui dormait, mit ses souliers rouges et toute seule sortit par la porte de la ville, vers le fleuve.
- Est-il vrai que tu m'as pris mon petit camarade de jeu ? Je te ferai cadeau de mes souliers rouges si tu me le rends.
Il lui sembla que les vagues lui faisaient signe, alors elle enleva ses souliers rouges, ceux auxquels elle tenait le plus, et les jeta tous les deux dans l'eau, mais ils tombèrent tout près du bord et les vagues les repoussèrent tout de suite vers elle, comme si la rivière ne voulait pas les accepter, puisqu'elle n'avait pas pris le petit Kay. Gerda crut qu'elle n'avait pas lancé les souliers assez loin, alors elle grimpa dans un bateau qui était là entre les roseaux, elle alla jusqu'au bout du bateau et jeta de nouveau ses souliers dans l'eau. Par malheur le bateau n'était pas attaché et dans le mouvement qu'elle fit il s'éloigna de la rive, elle s'en aperçut aussitôt et voulut retourner à terre, mais avant qu'elle n'y eût réussi, il était déjà loin sur l'eau et il s'éloignait de plus en plus vite.
Alors la petite Gerda fut prise d'une grande frayeur et se mit à pleurer, mais personne ne pouvait l'entendre, excepté les moineaux, et ils ne pouvaient pas la porter, ils volaient seulement le long de la rive, en chantant comme pour la consoler : " Nous voici ! Nous voici ! " Le bateau s'en allait à la dérive, la pauvre petite était là tout immobile sur ses bas, les petits souliers rouges flottaient derrière mais ne pouvaient atteindre la barque qui allait plus vite.
« Peut-être la rivière va-t-elle m'emporter auprès de Kay », pensa Gerda en reprenant courage. Elle se leva et durant des heures admira la beauté des rives verdoyantes. Elle arriva ainsi à un grand champ de cerisiers où se trouvait une petite maison avec de drôles de fenêtres rouges et bleues et un toit de chaume. Devant elle, deux soldats de bois présentaient les armes à ceux qui passaient. Gerda les appela croyant qu'ils étaient vivants, mais naturellement ils ne répondirent pas, elle les approcha de tout près et le flot poussa la barque droit vers la terre.
Gerda appela encore plus fort, alors sortit de la maison une vieille, vieille femme qui s'appuyait sur un bâton à crochet, elle portait un grand chapeau de soleil orné de ravissantes fleurs peintes.
- Pauvre petite enfant, dit la vieille, comment es-tu venue sur ce fort courant qui t'emporte loin dans le vaste monde ?
La vieille femme entra dans l'eau, accrocha le bateau avec le crochet de son bâton, le tira à la rive et en fit sortir la petite fille.
Gerda était bien contente de toucher le sol sec mais un peu effrayée par cette vieille femme inconnue.
- Viens me raconter qui tu es et comment tu es ici, disait-elle.
La petite lui expliqua tout et la vieille branlait la tête en faisant Hm ! Hm ! et comme Gerda, lui ayant tout dit, lui demandait si elle n'avait pas vu le petit Kay, la femme lui répondit qu'il n'avait pas passé encore, mais qu'il allait sans doute venir, qu'il ne fallait en tout cas pas qu'elle s'en attriste mais qu'elle entre goûter ses confitures de cerises, admirer ses fleurs plus belles que celles d'un livre d'images ; chacune d'elles savait raconter une histoire.
Alors elle prit Gerda par la main et elles entrèrent dans la petite maison dont la vieille femme ferma la porte.
Les fenêtres étaient situées très haut et les vitres en étaient rouges, bleues et jaunes, la lumière du jour y prenait des teintes étranges mais sur la table il y avait de délicieuses cerises, Gerda en mangea autant qu'il lui plut. Tandis qu'elle mangeait, la vieille peignait sa chevelure avec un peigne d'or et ses cheveux blonds bouclaient et brillaient autour de son aimable petit visage, tout rond, semblable à une rose.
- J'avais tant envie d'avoir une si jolie petite fille, dit la vieille, tu vas voir comme nous allons bien nous entendre !
A mesure qu'elle peignait les cheveux de Gerda, la petite oubliait de plus en plus son camarade de jeu, car la vieille était une magicienne, mais pas une méchante sorcière, elle s'occupait un peu de magie, comme ça, seulement pour son plaisir personnel et elle avait très envie de garder la petite fille auprès d'elle.
C'est pourquoi elle sortit dans le jardin, tendit sa canne à crochet vers tous les rosiers et, quoique chargés des fleurs les plus ravissantes, ils disparurent dans la terre noire, on ne voyait même plus où ils avaient été. La vieille femme avait peur que Gerda, en voyant les roses, ne vint à se souvenir de son rosier à elle, de son petit camarade Kay et qu'elle ne s'enfuie.
Ensuite, elle conduisit Gerda dans le jardin fleuri. Oh ! quel parfum délicieux ! Toutes les fleurs et les fleurs de toutes les saisons étaient là dans leur plus belle floraison, nul livre d'images n'aurait pu être plus varié et plus beau. Gerda sauta de plaisir et joua jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers. Alors on la mit dans un lit délicieux garni d'édredons de soie rouge bourrés de violettes bleues, et elle dormit et rêva comme une princesse au jour de ses noces.
Le lendemain elle joua encore parmi les fleurs, dans le soleil - et les jours passèrent. Gerda connaissait toutes les fleurs par leur nom, il y en avait tant et tant et cependant il lui semblait qu'il en manquait une, laquelle ? Elle ne le savait pas.
Un jour elle était là, assise, et regardait le chapeau de soleil de la vieille femme avec les fleurs peintes où justement la plus belle fleur était une rose. La sorcière avait tout à fait oublié de la faire disparaître de son chapeau en même temps qu'elle faisait descendre dans la terre les vraies roses . On ne pense jamais à tout !
- Comment, s'écria Gerda, il n'y pas une seule rose ici ? Elle sauta au milieu de tous les parterres, chercha et chercha, mais n'en trouva aucune. Alors elle s'assit sur le sol et pleura, mais ses chaudes larmes tombèrent précisément à un endroit où un rosier s'était enfoncé, et lorsque les larmes mouillèrent la terre, l'arbre reparut soudain plus magnifiquement fleuri qu'auparavant. Gerda l'entoura de ses bras et pensa tout d'un coup à ses propres roses de chez elle et à son petit ami Kay.
- Oh comme on m'a retardée, dit la petite fille. Et je devais chercher Kay ! Ne savez-vous pas où il est ? demanda-t-elle aux roses. Croyez-vous vraiment qu'il soit mort et disparu ?
- Non, il n'est pas mort, répondirent les roses, nous avons été sous la terre, tous les morts y sont et Kay n'y était pas !
- Merci, merci à vous, dit Gerda allant vers les autres fleurs. Elle regarda dans leur calice en demandant :
- Ne savez-vous pas où se trouve le petit Kay ?
Mais chaque fleur debout au soleil rêvait sa propre histoire, Gerda en entendit tant et tant, aucune ne parlait de Kay.
Mais que disait donc le lis rouge ?
- Entends-tu le tambour : Boum ! boum ! deux notes seulement, boum ! boum ! écoute le chant de deuil des femmes, l'appel du prêtre. Dans son long sari rouge, la femme hindoue est debout sur le bûcher, les flammes montent autour d'elle et de son époux défunt, mais la femme hindoue pense à l'homme qui est vivant dans la foule autour d'elle, à celui dont les yeux brûlent, plus ardents que les flammes, celui dont le regard touche son cœur plus que cet incendie qui bientôt réduira son corps en cendres. La flamme du cœur peut-elle mourir dans les flammes du bûcher ?
- Je n'y comprends rien du tout, dit la petite Gerda.
- C'est là mon histoire, dit le lis rouge.
Et que disait le liseron ?
- Là-bas, au bout de l'étroit sentier de montagne est suspendu un vieux castel, le lierre épais pousse sur les murs rongés, feuille contre feuille, jusqu'au balcon où se tient une ravissante jeune fille. Elle se penche sur la balustrade et regarde au loin sur le chemin. Aucune rose dans le branchage n'est plus fraîche que cette jeune fille, aucune fleur de pommier que le vent arrache à l'arbre et emporte au loin n'est plus légère. Dans le froufrou de sa robe de soie, elle s'agite : «Ne vient-il pas ?».
- Est-ce de Kay que tu parles ? demanda Gerda.
- Je ne parle que de ma propre histoire, de mon rêve, répondit le liseron.
Mais que dit le petit perce-neige ?
- Dans les arbres, cette longue planche suspendue par deux cordes, c'est une balançoire. Deux délicieuses petites filles - les robes sont blanches, de longs rubans verts flottent à leurs chapeaux - y sont assises et se balancent. Le frère, plus grand qu'elles, se met debout sur la balançoire, il passe un bras autour de la corde pour se tenir, il tient d'une main une petite coupe, de l'autre une pipe d'écume et il fait des bulles de savon. La balançoire va et vient, les bulles de savon aux teintes irisées s'envolent, la dernière tient encore à la pipe et se penche dans la brise. La balançoire va et vient. Le petit chien noir aussi léger que les bulles de savon se dresse sur ses pattes de derrière et veut aussi monter, mais la balançoire vole, le chien tombe, il aboie, il est furieux, on rit de lui, les bulles éclatent. Voilà ! une planche qui se balance, une écume qui se brise, voilà ma chanson ...
- C'est peut-être très joli ce que tu dis là, mais tu le dis tristement et tu ne parles pas de Kay.
Que dit la jacinthe ?
- Il y avait trois sœurs délicieuses, transparentes et délicates, la robe de la première était rouge, celle de la seconde bleue, celle de la troisième toute blanche. Elles dansaient en se tenant par la main près du lac si calme, au clair de lune. Elles n'étaient pas filles des elfes mais bien enfants des hommes. L'air embaumait d'un exquis parfum, les jeunes filles disparurent dans la forêt. Le parfum devenait de plus en plus fort - trois cercueils où étaient couchées les ravissantes filles glissaient d'un fourré de la forêt dans le lac, les vers luisants volaient autour comme de petites lumières flottantes. Dormaient-elles ces belles filles ? Etaient-elles mortes ? Le parfum des fleurs dit qu'elles sont mortes, les cloches sonnent pour les défuntes.
- Tu me rends malheureuse, dit la petite Gerda. Tu as un si fort parfum, qui me fait penser à ces pauvres filles. Hélas ! le petit Kay est-il vraiment mort ? Les roses qui ont été sous la terre me disent que non.
- Ding ! Dong ! sonnèrent les clochettes des jacinthes. Nous ne sonnons pas pour le petit Kay, nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson, c'est la seule que nous sachions.
Gerda se tourna alors vers le bouton d'or qui brillait parmi les feuilles vertes, luisant.
- Tu es un vrai petit soleil ! lui dit Gerda. Dis-moi si tu sais où je trouverai mon camarade de jeu ?
Le bouton d'or brillait tant qu'il pouvait et regardait aussi la petite fille. Mais quelle chanson savait-il ? On n'y parlait pas non plus de Kay :
- Dans une petite ferme, le soleil brillait au premier jour du printemps, ses rayons frappaient le bas du mur blanc du voisin, et tout près poussaient les premières fleurs jaunes, or lumineux dans ces chauds rayons. Grand-mère était assise dehors dans son fauteuil, sa petite fille, la pauvre et jolie servante rentrait d'une courte visite, elle embrassa la grand-mère. Il y avait de l'or du cœur dans ce baiser béni. De l'or sur les lèvres, de l'or au fond de l'être, de l'or dans les claires heures du matin. Voilà ma petite histoire, dit le bouton d'or.
- Ma pauvre vieille grand-mère, soupira Gerda. Elle me regrette sûrement et elle s'inquiète comme elle s'inquiétait pour Kay. Mais je rentrerai bientôt et je ramènerai Kay. Cela ne sert à rien que j'interroge les fleurs, elles ne connaissent que leur propre chanson, elles ne savent pas me renseigner.
Elle retroussa sa petite robe pour pouvoir courir plus vite, mais le narcisse lui fit un croc-en-jambe au moment où elle sautait par-dessus lui. Alors elle s'arrêta, regarda la haute fleur et demanda :
- Sais-tu par hasard quelque chose ?
Elle se pencha très bas pour être près de lui. Et que dit-il ?
- Je me vois moi- même, je me vois moi-même ! Oh! Oh! quel parfum je répands ! Là-haut dans la mansarde, à demi vêtue, se tient une petite danseuse, tantôt sur une jambe, tantôt sur les deux, elle envoie promener le monde entier de son pied, au fond elle n'est qu'une illusion visuelle, pure imagination. Elle verse l'eau de la théière sur un morceau d'étoffe qu'elle tient à la main, c'est son corselet - la propreté est une bonne chose - la robe blanche est suspendue à la patère, elle a aussi été lavée dans la théière et séchée sur le toit. Elle met la robe et un fichu jaune safran autour du cou pour que la robe paraisse plus blanche. La jambe en l'air ! dressée sur une longue tige, c'est moi, je me vois moi-même.
- Mais je m'en moque, cria Gerda, pourquoi me raconter cela ?
Elle courut au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle remua la charnière rouillée qui céda, la porte s'ouvrit. Alors la petite Gerda, sans chaussures, s'élança sur ses bas dans le monde.
Elle se retourna trois fois, mais personne ne la suivait ; à la fin, lasse de courir, elle s'assit sur une grande pierre. Lorsqu'elle regarda autour d'elle, elle vit que l'été était passé, on était très avancé dans l'automne, ce qu'on ne remarquait pas du tout dans le jardin enchanté où il y avait toujours du soleil et toutes les fleurs de toutes les saisons.
- Mon Dieu que j'ai perdu de temps ! s'écria la petite Gerda. Voilà que nous sommes en automne, je n'ai pas le droit de me reposer.
Elle se leva et repartit.
Comme ses petits pieds étaient endoloris et fatigués ! Autour d'elle tout était froid et hostile, les longues feuilles du saule étaient toutes jaunes et le brouillard s'égouttait d'elles, une feuille après l'autre tombait à terre, seul le prunellier avait des fruits âcres à vous en resserrer toutes les gencives. Oh ! que tout était gris et lourd dans le vaste monde ! | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Jeu 3 Nov - 20:02 Jeu 3 Nov - 20:02 | |
| CINQUIEME HISTOIRE
LA PETITE FILLE DES BRIGANDS
On roulait à travers la sombre forêt et le carrosse luisait comme un flambeau. Des brigands qui se trouvaient là en eurent les yeux blessés, il ne pouvaient le supporter.
- De l'or ! de l'or ! criaient-ils.
S'élançant à la tête des chevaux, ils massacrèrent les petits postillons, le cocher et les valets et tirèrent la petite Gerda hors de la voiture.
- Elle est grassouillette, elle est mignonne et nourrie d'amandes, dit la vieille brigande qui avait une longue barbe broussailleuse et des sourcils qui lui tombaient sur les yeux. C'est joli comme un petit agneau gras, ce sera délicieux à manger.
Elle tira son grand couteau et il luisait d'une façon terrifiante.
- Aie ! criait en même temps cette mégère.
Sa propre petite fille qu'elle portait sur le dos et qui était sauvage et mal élevée à souhait, venait de la mordre à l'oreille.
- Sale petite ! fit la mère.
Elle n'eut pas le temps de tuer Gerda, sa petite fille lui dit :
- Elle jouera avec moi, qu'elle me donne son manchon, sa jolie robe et je la laisserai coucher dans mon lit.
Elle mordit de nouveau sa mère qui se débattait et se tournait de tous les côtés. Les brigands riaient.
- Voyez comme elle danse avec sa petite !
- Je veux monter dans le carrosse, dit la petite fille des brigands.
Et il fallut en passer par où elle voulait, elle était si gâtée et si difficile. Elle s'assit auprès de Gerda et la voiture repartit par-dessus les souches et les broussailles plus profondément encore dans la forêt. La fille des brigands était de la taille de Gerda mais plus forte, plus large d'épaules, elle avait le teint sombre et des yeux noirs presque tristes. Elle prit Gerda par la taille, disant :
- Ils ne te tueront pas tant que je ne serai pas fâchée avec toi. Tu es sûrement une princesse.
- Non, répondit Gerda.
Et elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et combien elle aimait le petit Kay.
La fille des brigands la regardait d'un air sérieux, elle fit un signe de la tête.
Elle essuya les yeux de Gerda et mit ses deux mains dans le manchon. Qu'il était doux !
Le carrosse s'arrêta, elles étaient au milieu de la cour d'un château de brigands, tout lézardé du haut en bas, des corbeaux, des corneilles s'envolaient de tous les trous et les grands bouledogues, qui avaient chacun l'air capable d'avaler un homme, bondissaient mais n'aboyaient pas, cela leur était défendu.
Dans la grande vieille salle noire de suie, brûlait sur le dallage de pierres un grand feu, la fumée montait vers le plafond et cherchait une issue, une grande marmite de soupe bouillait et sur des broches rôtissaient lièvres et lapins.
- Tu vas dormir avec moi et tous mes petits animaux préférés ! dit la fille des brigands.
Après avoir bu et mangé elles allèrent dans un coin où il y avait de la paille et des couvertures. Au-dessus, sur des lattes et des barreaux se tenaient une centaine de pigeons qui avaient tous l'air de dormir mais ils tournèrent un peu la tête à l'arrivée des fillettes.
- Ils sont tous à moi, dit la petite fille des brigands.
Elle attrapa un des plus proches, le tint par les pattes.
- Embrasse-le ! cria-t-elle en le claquant à la figure de Gerda.
- Et voilà toutes les canailles de la forêt, continua-t-elle, en montrant une quantité de barreaux masquant un trou très haut dans le mur.
- Ce sont les canailles de la forêt, ces deux-là, ils s'envolent tout de suite si on ne les enferme pas bien. Et voici le plus chéri, mon vieux Bée !
Elle tira par une corne un renne qui portait un anneau de cuivre poli autour du cou et qui était attaché.
- Il faut aussi l'avoir à la chaîne celui-là, sans quoi il bondit et s'en va. Tous les soirs je lui caresse le cou avec mon couteau aiguisé, il en a une peur terrible, ajouta-t-elle.
Elle prit un couteau dans une fente du mur et le fit glisser sur le cou du pauvre renne qui ruait, mais la fille des brigands ne faisait qu'en rire. Elle entraîna Gerda vers le lit.
- Est-ce que tu le gardes près de toi pour dormir ? demanda Gerda.
- Je dors toujours avec un couteau, dit la fille des brigands. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais répète-moi ce que tu me racontais de Kay.
Tandis que la petite Gerda racontait, les pigeons de la forêt roucoulaient là- haut dans leur cage, les autres pigeons dormaient. La fille des brigands dormait et ronflait, une main passée autour du cou de Gerda et le couteau dans l'autre, mais Gerda ne put fermer l'œil, ne sachant si elle allait vivre ou mourir.
Alors, les pigeons de la forêt dirent :
- Crouou ! Crouou ! nous avons vu le petit Kay. Une poule blanche portait son traîneau, lui était assis dans celui de la Reine des Neiges, qui volait bas au-dessus de la forêt, nous étions dans notre nid, la Reine a soufflé sur tous les jeunes et tous sont morts, sauf nous deux. Crouou ! Crouou !
- Que dites-vous là-haut ? cria Gerda. Où la Reine des Neiges est-elle partie ?
- Elle allait sûrement vers la Laponie où il y a toujours de la neige et de la glace. Demande au renne qui est attaché à la corde.
- Il y a de glace et de la neige, c'est agréable et bon, dit le renne. Là, on peut sauter, libre, dans les grandes plaines brillantes, c'est là que la Reine des Neiges a sa tente d'été, mais son véritable château est près du pôle Nord, sur une île appelée Spitzberg.
- Oh ! mon Kay, mon petit Kay, soupira Gerda.
- Si tu ne te tiens pas tranquille, dit la fille des brigands à demi réveillée, je te plante le couteau dans le ventre.
Au matin Gerda raconta à la fillette ce que les pigeons, le renne, lui avaient dit et la fille des brigands avait un air très sérieux, elle disait :
- Ça m'est égal ! ça m'est égal !
- Sais-tu où est la Laponie ? demanda-t-elle au renne.
- Qui pourrait le savoir mieux que moi, répondit l'animal dont les yeux étincelèrent. C'est là que je suis né, que j'ai joué et bondi sur les champs enneigés.
- Ecoute, dit la fille des brigands à Gerda, tu vois que maintenant tous les hommes sont partis, la mère est toujours là et elle restera, mais bientôt elle va se mettre à boire à même cette grande bouteille là-bas et elle se paiera ensuite un petit somme supplémentaire - alors je ferai quelque chose pour toi.
Lorsque la mère eut bu la bouteille et se fut rendormie, la fille des brigands alla vers le renne et lui dit :
- Cela m'aurait amusé de te chatouiller encore souvent le cou avec mon couteau aiguisé car tu es si amusant quand tu as peur, mais tant pis, je vais te détacher et t'aider à sortir pour que tu puisses courir jusqu'en Laponie mais il faudra prendre tes jambes à ton cou et m'apporter cette petite fille au château de la Reine des Neiges où est son camarade de jeu. Tu as sûrement entendu ce qu'elle a raconté, elle parlait assez fort et tu es toujours à écouter.
Le renne sauta en l'air de joie. La fille des brigands souleva Gerda et prit la précaution de l'attacher fermement sur le dos de la bête, elle la fit même asseoir sur un petit coussin.
- Ça m'est égal, dit-elle. Prends tes bottines fourrées car il fera froid, mais le manchon je le garde, il est trop joli. Et comme je ne veux pas que tu aies froid, voilà les immense moufles de ma mère, elles te monteront jusqu'au coude
- fourre-moi tes mains là-dedans. Et voilà, par les mains tu ressembles à mon affreuse mère.
Gerda pleurait de joie.
- Assez de pleurnicheries, je n'aime pas ça, tu devrais avoir l'air contente au contraire, voilà deux pains et un jambon, tu ne souffriras pas de la faim.
Elle attacha les deux choses sur le renne, ouvrit la porte, enferma les grands chiens, puis elle coupa avec son couteau la corde du renne et lui dit :
-Va maintenant, cours, mais fais bien attention à la petite fille.
Gerda tendit ses mains gantées des immenses moufles vers la fille des brigands pour dire adieu et le renne détala par-dessus les buissons et les souches, à travers la grande forêt par les marais et par la steppe, il courait tant qu'il pouvait. Les loups hurlaient, les corbeaux croassaient. Le ciel faisait pfut ! pfut ! comme s'il éternuait rouge.
- C'est la chère vieille aurore boréale, dit le renne, regarde cette lumière !
Et il courait, il courait, de jour et de nuit.
On mangea les pains, et le jambon aussi. Et ils arrivèrent en Laponie.
| |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Jeu 3 Nov - 20:02 Jeu 3 Nov - 20:02 | |
| SIXIEME HISTOIRE
LA FEMME LAPONE ET LA FINNOISE
Ils s'arrêtèrent près d'une petite maison très misérable, le toit descendait jusqu'à terre et la porte était si basse que la famille devait ramper sur le ventre pour y entrer. Il n'y avait personne au logis qu'une vieille femme lapone qui faisait cuire du poisson sur une lampe à huile de foie de morue. Le renne lui raconta toute l'histoire de Gerda, mais d'abord la sienne qui semblait être beaucoup plus importante et Gerda était si transie de froid qu'elle ne pouvait pas parler.
- Hélas ! pauvres de vous, s'écria la femme, vous avez encore beaucoup à courir, au moins cent lieues encore pour atteindre le Finmark, c'est là qu'est la maison de campagne de la Reine des Neiges, et les aurores boréales s'y allument chaque soir. Je vais vous écrire un mot sur un morceau de morue, je n'ai pas de papier, et vous le porterez à la femme finnoise là-haut, elle vous renseignera mieux que moi.
Lorsque Gerda fut un peu réchauffée, quand elle eut bu et mangé, la femme lapone écrivit quelques mots sur un morceau de morue séchée, recommanda à Gerda d'y faire bien attention, attacha de nouveau la petite fille sur le renne - et en route ! Pfut ! pfut ! entendait-on dans l'air, la plus jolie lumière bleue brûlait là-haut.
Ils arrivèrent au Finmark et frappèrent à la cheminée de la finnoise car là il n'y avait même pas de porte.
Quelle chaleur dans cette maison ! la Finnoise y était presque nue, petite et malpropre. Elle défit rapidement les vêtements de Gerda, lui enleva les moufles et les bottines pour qu'elle n'ait pas trop chaud, mit un morceau de glace sur la tête du renne et commença à lire ce qui était écrit sur la morue séchée. Elle lut et relut trois fois, ensuite, comme elle le savait par cœur, elle mit le morceau de poisson à cuire dans la marmite, c'était bon à manger et elle ne gaspillait jamais rien.
Le renne raconta d'abord sa propre histoire puis celle de Gerda. La Finnoise clignait de ses yeux intelligents mais ne disait rien.
- Tu es très remarquable, dit le renne, je sais que tu peux attacher tous les vents du monde avec un simple fil à coudre, si le marin défait un nœud il a bon vent, S'il défait un second nœud, il vente fort, et s'il défait le troisième et le quatrième, la tempête est si terrible que les arbres des forêts sont renversés. Ne veux-tu pas donner à cette petite fille un breuvage qui lui assure la force de douze hommes et lui permette de vaincre la Reine des Neiges ?
- La force de douze hommes, dit la Finnoise, oui, ça suffira bien.
Elle alla vers une tablette, y prit une grande peau roulée, la déroula. D'étranges lettres y étaient gravées, la Finnoise les lisait et des gouttes de sueur tombaient de son front.
Le renne la pria encore si fort pour Gerda et la petite la regarda avec des yeux si suppliants, si pleins de larmes que la Finnoise se remit à cligner des siens. Elle attira le renne dans un coin et lui murmura quelque chose tout en lui mettant de la glace fraîche sur la tête.
- Le petit Kay est en effet chez la Reine des Neiges et il y est parfaitement heureux, il pense qu'il se trouve là dans le lieu le meilleur du monde, mais tout ceci vient de ce qu'il a reçu un éclat de verre dans le cœur et une poussière de verre dans l'œil, il faut que ce verre soit extirpé sinon il ne deviendra jamais un homme et la Reine des Neiges conservera son pouvoir sur lui.
- Mais ne peux-tu faire prendre à Gerda un breuvage qui lui donnerait un pouvoir magique sur tout cela ?
- Je ne peux pas lui donner un pouvoir plus grand que celui qu'elle a déjà. Ne vois-tu pas comme il est grand, ne vois-tu pas comme les hommes et les animaux sont forcés de la servir, comment pieds nus elle a réussi à parcourir le monde ? Ce n'est pas par nous qu'elle peut gagner son pouvoir qui réside dans son cœur d'enfant innocente et gentille. Si elle ne peut pas par elle- même entrer chez la Reine des Neiges et arracher les morceaux de verre du cœur et des yeux de Kay, nous, nous ne pouvons l'aider.
Le jardin de la Reine commence à deux lieues d'ici, conduis la petite fille jusque-là, fais-la descendre près du buisson qui, dans la neige, porte des baies rouges, ne tiens pas de parlotes inutiles et reviens au plus vite.
Ensuite la femme finnoise souleva Gerda et la replaça sur le dos du renne qui repartit à toute allure.
- Oh ! Je n'ai pas mes bottines, je n'ai pas mes moufles, criait la petite Gerda, s'en apercevant dans le froid cuisant.
Le renne n'osait pas s'arrêter, il courait, il courait ... Enfin il arriva au grand buisson qui portait des baies rouges, là il mit Gerda à terre, l'embrassa sur la bouche. De grandes larmes brillantes roulaient le long des joues de l'animal et il se remit à courir, aussi vite que possible pour s'en retourner.
Et voilà ! la pauvre Gerda, sans chaussures, sans gants, dans le terrible froid du Finmark.
Elle se mit à courir en avant aussi vite que possible mais un régiment de flocons de neige venaient à sa rencontre, ils ne tombaient pas du ciel qui était parfaitement clair et où brillait l'aurore boréale, ils couraient sur la terre et à mesure qu'ils s'approchaient, ils devenaient de plus en plus grands. Gerda se rappelait combien ils étaient grands et bien faits le jour où elle les avait regardés à travers la loupe, mais ici ils étaient encore bien plus grands, effrayants, vivants, l'avant garde de la Reine des Neiges. Ils prenaient les formes les plus bizarres, quelques uns avaient l'air de grands hérissons affreux, d'autres semblaient des nœuds de serpents avançant leurs têtes, d'autres ressemblaient à de gros petits ours au poil luisant. Ils étaient tous d'une éclatante blancheur.
Alors la petite Gerda se mit à dire sa prière. Le froid était si intense que son haleine sortait de sa bouche comme une vraie fumée, cette haleine devint de plus en plus dense et se transforma en petits anges lumineux qui grandissaient de plus en plus en touchant la terre, ils avaient tous des casques sur la tête, une lance et un bouclier dans les mains, ils étaient de plus en plus nombreux. Lorsque Gerda eut fini sa prière ils formaient une légion autour d'elle. Ils combattaient de leurs lances les flocons de neige et les faisaient éclater en mille morceaux et la petite Gerda s'avança d'un pas assuré, intrépide. Les anges lui tapotaient les pieds et les mains, elle ne sentait plus le froid et marchait rapidement vers le château.
Maintenant il nous faut d'abord voir comment était Kay. Il ne pensait absolument pas à la petite Gerda, et encore moins qu'elle pût être là, devant le château.
SEPTIEME HISTOIRE
CE QUI S'ETAIT PASSE AU CHATEAU DE LA REINE
DES NEIGES ET CE QUI EUT LIEU PAR LA SUITE
Les murs du château étaient faits de neige pulvérisée, les fenêtres et les portes de vents coupants, il y avait plus de cent salles formées par des tourbillons de neige. La plus grande s'étendait sur plusieurs lieues, toutes étaient éclairées de magnifiques aurores boréales, elles étaient grandes, vides, glacialement froides et étincelantes.
Aucune gaieté ici, pas le plus petit bal d'ours où le vent aurait pu souffler et les ours blancs marcher sur leurs pattes de derrière en prenant des airs distingués. Pas la moindre partie de cartes amenant des disputes et des coups, pas la moindre invitation au café de ces demoiselles les renardes blanches, les salons de la Reine des Neiges étaient vides, grands et glacés. Les aurores boréales luisaient si vivement et si exactement que l'on pouvait prévoir le moment où elles seraient à leur apogée et celui où, au contraire, elles seraient à leur décrue la plus marquée. Au milieu de ces salles neigeuses, vides et sans fin, il y avait un lac gelé dont la glace était brisée en mille morceaux, mais en morceaux si identiques les uns aux autres que c'était une véritable merveille. Au centre trônait la Reine des Neiges quand elle était à la maison. Elle disait qu'elle siégerait là sur le miroir de la raison, l'unique et le meilleur au monde.
Le petit Kay était bleu de froid, même presque noir, mais il ne le remarquait pas, un baiser de la reine lui avait enlevé la possibilité de sentir le frisson du froid et son cœur était un bloc de glace - ou tout comme. Il cherchait à droite et à gauche quelques morceaux de glace plats et coupants qu'il disposait de mille manières, il voulait obtenir quelque chose comme nous autres lorsque nous voulons obtenir une image en assemblant de petites plaques de bois découpées (ce que nous appelons jeu chinois ou puzzle). Lui aussi voulait former des figures et les plus compliquées, ce qu'il appelait le « jeu de glace de la raison » qui prenait à ses yeux une très grande importance, par suite de l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil. Il formait avec ces morceaux de glace un mot mais n'arrivait jamais à obtenir le mot exact qu'il aurait voulu, le mot « Eternité ». La Reine des Neiges lui avait dit :
- Si tu arrives à former ce mot, tu deviendras ton propre maître, je t'offrirai le monde entier et une paire de nouveaux patins. Mais il n'y arrivait pas ...
- Maintenant je vais m'envoler vers les pays chauds, dit la Reine, je veux jeter un coup d'œil dans les marmites noires.
Elle parlait des volcans qui crachent le feu, l'Etna et le Vésuve.
- Je vais les blanchir ; un peu de neige, cela fait partie du voyage et fait très bon effet sur les citronniers et la vigne.
Elle s'envola et Kay resta seul dans les immenses salles vides. Il regardait les morceaux de glace et réfléchissait, il réfléchissait si intensément que tout craquait en lui, assis là raide, immobile, on aurait pu le croire mort, gelé.
Et c'est à ce moment que la petite Gerda entra dans le château par le grand portail fait de vents aigus. Elle récita sa prière du soir et le vent s'apaisa comme s'il allait s'endormir. Elle entra dans la grande salle vide et glacée ... Alors elle vit Kay, elle le reconnut, elle lui sauta au cou, le tint serré contre elle et elle criait :
- Kay ! mon gentil petit Kay ! je te retrouve enfin.
Mais lui restait immobile, raide et froid - alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine du petit garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur, firent fondre le bloc de glace, entraînant l'éclat de verre qui se trouvait là.
Il la regarda, elle chantait le psaume :
Les roses poussent dans les vallées
Où l'enfant Jésus vient nous parler.
Alors Kay éclata en sanglots. Il pleura si fort que la poussière de glace coula hors de son œil. Il reconnut Gerda et cria débordant de joie :
- Gerda, chère petite Gerda, où es-tu restée si longtemps? Ou ai-je été moi-même? Il regarda alentour.
- Qu'il fait froid ici, que tout est vide et grand.
Il se serrait contre sa petite amie qui riait et pleurait de joie. Un infini bonheur s'épanouissait, les morceaux de glace eux-mêmes dansaient de plaisir, et lorsque les enfants s'arrêtèrent, fatigués, ils formaient justement le mot que la Reine des Neiges avait dit à Kay de composer : « Éternité ». Il devenait donc son propre maître, elle devait lui donner le monde et une paire de patins neufs.
Gerda lui baisa les joues et elle devinrent roses, elle baisa ses yeux et ils brillèrent comme les siens, elle baisa ses mains et ses pieds et il redevint sain et fort. La Reine des Neiges pouvait rentrer, la lettre de franchise de Kay était là écrite dans les morceaux de glace étincelants : Eternité ...
Alors les deux enfants se prirent par la main et sortirent du grand château. Ils parlaient de grand-mère et des rosiers sur le toit, les vents s'apaisaient, le soleil se montrait. Ils atteignirent le buisson aux baies rouges, le renne était là et les attendait. Il avait avec lui une jeune femelle dont le pis était plein, elle donna aux enfants son lait chaud et les baisa sur la bouche.
Les deux animaux portèrent Kay et Gerda d'abord chez la femme finnoise où ils se réchauffèrent dans sa chambre, et qui leur donna des indications pour le voyage de retour, puis chez la femme lapone qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait préparé son traîneau.
Les deux rennes bondissaient à côté d'eux tandis qu'ils glissaient sur le traîneau, ils les accompagnèrent jusqu'à la frontière du pays où se montraient les premières verdures : là ils firent leurs adieux aux rennes et à la femme lapone.
- Adieu ! Adieu ! dirent-ils tous.
Les premiers petits oiseaux se mirent à gazouiller, la forêt était pleine de pousses vertes. Et voilà que s'avançait vers eux sur un magnifique cheval que Gerda reconnut aussitôt (il avait été attelé devant le carrosse d'or), s'avançait vers eux une jeune fille portant un bonnet rouge et tenant des pistolets devant elle, c'était la petite fille des brigands qui s'ennuyait à la maison et voulait voyager, d'abord vers le nord, ensuite ailleurs si le nord ne lui plaisait pas.
- Tu t'y entends à faire trotter le monde, dit-elle au petit Kay, je me demande si tu vaux la peine qu'on coure au bout du monde pour te chercher.
Gerda lui caressa les joues et demanda des nouvelles du prince et de la princesse.
- Ils sont partis à l'étranger, dit la fille des brigands.
- Et la corneille ? demanda Gerda.
- La corneille est morte, répondit-elle. Sa chérie apprivoisée est veuve et porte un bout de laine noire à la patte, elle se plaint lamentablement, quelle bêtise ! Mais raconte-moi ce qui t'est arrivé et comment tu l'as retrouvé ?
Gerda et Kay racontaient tous les deux en même temps.
- Et patati, et patata, dit la fille des brigands, elle leur serra la main à tous les deux et promit, si elle traversait leur ville, d'aller leur rendre visite ... et puis elle partit dans le vaste monde.
Kay et Gerda allaient la main dans la main et tandis qu'ils marchaient, un printemps délicieux plein de fleurs et de verdure les enveloppait. Les cloches sonnaient, ils reconnaissaient les hautes tours, la grande ville où ils habitaient. Il allèrent à la porte de grand-mère, montèrent l'escalier, entrèrent dans la chambre où tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait tic-tac, les aiguilles tournaient, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus des grandes personnes.
Les rosiers dans la gouttière étendaient leurs fleurs à travers les fenêtres ouvertes. Leurs petites chaises d'enfants étaient là, Kay et Gerda s'assirent chacun sur la sienne en se tenant toujours la main, ils avaient oublié, comme on oublie un rêve pénible, les splendeurs vides du château de la Reine des Neiges. Grand-mère était assise dans le clair soleil de Dieu et lisait la Bible à voix haute : « Si vous n'êtes pas semblables à des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. »
Kay et Gerda se regardèrent dans les yeux et comprirent d'un coup le vieux psaume :
Les roses poussent dans
les vallées
Où l'enfant Jésus vient
nous parler.
Ils étaient assis là, tous deux, adultes et cependant enfants, enfants par le cœur...
C'était l'été, le doux été béni. | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Jeu 3 Nov - 20:03 Jeu 3 Nov - 20:03 | |
| Voilà, j'espère que pour ceux qui ont lu, vous avez apprécié  | |
|   | | samara
Modérateur


Nombre de messages : 2364
Le nom et l'espèce de mes animaux : Anouk(siamoise)Yoyo et Colo ( persans),Fafie et Kikiventry (burmese)DamePlume,Lagwise, Indianna(dom)
Date d'inscription : 13/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Mer 23 Nov - 0:46 Mer 23 Nov - 0:46 | |
| C'est cool Zazou! La Reine des neiges était mon conte favori quand j'étais jeune. D'ailleurs il y a un film qui a été fait dans les années 70 et il était superbe.
Dernière édition par le Mer 23 Nov - 20:48, édité 1 fois | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Mer 23 Nov - 19:08 Mer 23 Nov - 19:08 | |
| Bon enfin, je suis contente que ça plaise à quelqu'un J'ai jamais vu ce film...Je suis certaine que j'adorerais... Il faudrait que je me loue ça.  | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Ven 25 Nov - 12:10 Ven 25 Nov - 12:10 | |
| Un autre conte que j'adore qui est dans le même genre
La princesse sous verre
par
Jean LORRAIN
I
C’était une délicate et belle petite princesse aux membres menus et jolis comme ceux d’une figurine de cire ; sa peau transparente était si tendre qu’on l’eût dit animée par une flamme de cierge, une flamme vacillante, éteinte au moindre vent et, sous ses épais bandeaux du marron luisant des châtaignes, elle dégageait, la petite princesse, une si prenante et si froide impression de blancheur qu’à son nom de Bertrade on avait ajouté le surnom de la pâle (on, c’était le bas peuple), tandis que son père, un vieux roi belliqueux toujours occupé à guerroyer contre les païens dans les Marches du Nord, l’avait baptisée sa petite rose de Noël ; et des neigeuses fleurs en effet Bertrade avait bien la fragilité morbide, le charme frêle et l’éclat apaisé, comme amorti par l’hiver.
Elle avait eu une enfance un peu assombrie dans ce château de pays de bois et de marais, où son père l’avait fait élever par des gouvernantes à faces de béguines, loin du tumulte de la cour.
Sa mère, une princesse d’Occitanie qui n’avait jamais pu se consoler d’avoir quitté le royaume aux grèves d’or, était morte quelques mois après sa naissance ; et ce deuil précoce avait à jamais enténébré de mélancolie cette royale petite enfance désormais confiée à des mains mercenaires.
Elle était née si chétive et si pâle qu’on avait longtemps craint qu’elle ne survécût pas à sa mère. Épousée presque sans apport pour la grande beauté de sa chair de lait et de ses longs yeux un peu égarés, du bleu verdissant des turquoises, cette fille d’empereur, à peine arrivée en Courlande, y était tombée dans une étrange langueur ; un incurable regret la minait, disait-on, des horizons de mâts, de vergues et de voilures qu’elle avait là-bas sous les yeux, au pied même des terrasses du palais impérial, dans la ville éternellement pavoisée de banderoles et d’étendards de l’Exarque son père. On n’a pas été impunément élevée au bord de la mer, et les rumeurs de l’Océan, les cris des matelots en partance, les mille et une clameurs d’un port manquaient à cette belle fleur marine qui, transplantée dans cette morne et plate Courlande, toute de tourbières et de forêts, s’y était rapidement fanée de nostalgie, étiolée de regret.
Son horreur pour les horizons de sapins et d’étangs de son nouveau royaume était devenue telle, que dans les derniers mois de sa vie, elle avait fait murer jusqu’à mi-hauteur les fenêtres à meneaux de sa chambre, cette chambre de brocart et de vieilles tapisseries, dont elle ne devait plus sortir que les bras croisés sur un crucifix et les pieds raidis dans un cercueil ; et les dolentes journées des derniers temps de sa grossesse et les heures saignantes de ses relevailles, elle les avait passées dans le clair-obscur de la chambre assombrie, les yeux fixés sur un grand miroir placé très haut, vis-à-vis des fenêtres à moitié condamnées, et qui ne reflétait que les nuées errantes et les aspects changeants du ciel.
Sa rêverie ainsi volontairement abusée pouvait se croire encore en Occitanie, sous les firmaments balayés de nuages à cassures de nacre des bords de la mer.
Cette obsession d’exilée avait abrégé ses jours, c’était du moins le bruit accrédité dans le peuple ; mais chez les grands on parlait d’un breuvage néfaste et de la haine d’une princesse du sang, jadis honorée des faveurs du roi et qui avait rêvé de s’asseoir sur la pourpre ; la jeune reine aurait payé de sa vie la rancune d’une rivale. Le poison, qu’on lui aurait versé, devait supprimer avec elle l’enfant dont elle était grosse ; mais soit que les doses eussent été mal calculées, soit que le ciel ait eu la pitié de ces deux cadavres pour un même cercueil, la reine seule était morte et Bertrade avait survécu.
C’était d’ailleurs une cour assez sinistre et pleine d’histoires étranges que cette cour de Courlande : en même temps que Bertrade y grandissait délicate et frêle aux mains des gouvernantes, dans le calme du château des Bois, le roi y faisait élever à la cour un sien neveu, fils d’un frère aîné, le frère même dont il occupait le trône, mort assez singulièrement dans une embuscade de chasse.
Le prince Noir (c’était ainsi qu’on appelait le prince Otto dans le peuple) était un assez taciturne jeune homme, de cinq années plus âgé que Bertrade, et dont l’incohérente et bizarre conduite autorisait plus d’un mauvais propos.
Aussi pâle que sa royale cousine, mais d’une maigreur souple et robuste, il promenait dans les palais de la haute ville, comme dans les bouges du vieux port, un svelte corps d’écuyer toujours sanglé de droguet noir. Il passait des pires débauches, de celles dont on peut à peine parler, aux pratiques de la piété la plus ardente ; on citait de lui des actes de charité presque divine à côté de faits d’une cruauté sauvage, et c’était à la fois le plus effréné libertin du royaume et le plus doux des jeunes moines enlumineurs de manuscrits de toutes les provinces ; car, dans son inexplicable sauvagerie, il lui arrivait parfois de se retirer tout un long mois dans un cloître et d’y mener la vie des postulants.
Ses regards fixes et durs, d’une froideur d’onyx, disaient assez son âme violente. On ne lui avait pas versé de breuvage à lui, mais une rumeur populaire voulait qu’il expiât à sa façon une vengeance de Bohémiens. Un zingaro dont, par caprice, il avait pour une nuit confisqué la maîtresse et qu’il avait fait (ce sont là jeux de princes) ensuite rouer de coups, lui avait donné à quelque temps de là une singulière aubade. Insinué on ne sait comment jusqu’aux appartements du prince (il y a toujours de la diablerie dans ces histoires de Bohême), ce misérable, au lieu de planter sa dague au coeur de son ennemi, lui avait toute la nuit chanté des airs de son pays en s’accompagnant d’un violon maléficié, un violon ou une guzla dont les cordes étaient faites de cheveux de pendu. L’âme du supplicié, quelque bandit de sa tribu branché aux bois de justice, avait toute la nuit torturé le sommeil du prince et, depuis ce cauchemar, la raison d’Otto avait sombré dans l’inconnu.
Le vieux roi, accablé par tant de désastres, haussait les épaules et laissait dire, mais avait dû renoncer à tout projet d’union entre le prince et sa cousine. Il avait pourtant longtemps caressé ce dessein d’unir au bel Otto sa petite rose de Noël, mais il eût été cruel de livrer cette délicate et délicieuse Bertrade à ce fou maniaque et imprévu.
La princesse avait alors seize ans. Elle n’avait pas seulement de sa mère l’ovale un peu souffrant de la face, les épaules tombantes, où le bleu des veines transparaît sous la peau, et le regard poignant des prunelles lointaines, d’un vert d’eau de fleuve chez la morte, d’un violet d’améthyste chez Bertrade. De la reine elle avait aussi hérité une sorte de mélancolie inquiète qui lui faisait rechercher, de préférence aux entretiens à la fenêtre et aux promenades en plein air, le clair-obscur des chambres et les vagues soliloques devant les miroirs ; ses plaisirs favoris étaient de s’enfermer durant de longues heures dans quelque haute salle tendue de tapisseries, dont les personnages de laine et de soie finissaient par s’animer insensiblement sous ses yeux. Si elle regardait le soleil, c’était à travers le chaton des bagues, dont on chargeait ses doigts effilés, et on l’avait souvent surprise, au clair de lune, s’amusant à faire ruisseler dans la lumière astrale l’eau chatoyante de ses colliers.
Dans toute la nature elle ne paraissait aimer que les reflets. L’eau aussi l’attirait et les seules fleurs dont elle souffrît la présence étaient l’iris et le nénuphar ; elle aimait au crépuscule à s’attarder aux bords glacés des sources et dans le brouillard fiévreux des étangs, mais à tout au monde elle préférait les interminables et silencieuses haltes devant l’étain figé des glaces ; l’âme de sa mère semblait l’y retenir, remontée des ténèbres à la surface équivoque des miroirs.
C’est alors que doucement et, sans que rien eût pu faire prévoir cette fin précoce, s’éteignit ou plutôt s’endormit entre les mains de ses suivantes la princesse Bertrade ; elle était dans le sixième mois de sa seizième année et, la veille encore, avait passé la journée dans un couvent de Clarisses, où les nonnes lui avaient fait grande fête. Au retour, dans l’or brûlant du crépuscule, elle avait fait arrêter sa litière au milieu des blés mûrs pour écouter la voix d’un moissonneur qui chantait ; le lendemain, elle était morte.
En l’absence du roi prévenu par courrier, les gouvernantes en pleurs baignèrent et parfumèrent d’essences ce pur et blanc cadavre, le vêtirent de moire et de brocart d’argent, puis, ayant peigné et natté la soie luisante de ses cheveux, la couronnèrent de roses de perle et de moelle de roseaux, comme on en voit aux statues des Madones. Elles joignirent sur un grand lis de filigrane d’or ses petites mains étincelantes de bagues, chaussèrent ses pieds de pantoufles de vair et, prosternées au pied d’un double rang de cierges, attendirent en grande douleur.
Mais, quand le roi accablé de chagrins et d’années pénétra dans la chambre ardente, accompagné de l’évêque Afranus crossé, mitré d’or et la dalmatique violette aux épaules, avec, sur leurs pas, un cortège en deuil d’archidiacres et de médecins, on découvrit que celle qu’on croyait morte n’était qu’endormie, mais de quel étrange et lugubre sommeil ! Rien ne put la rappeler à la vie, ni les prières des prêtres, ni toutes les tentatives des maîtres mires et physiciens. Trois jours durant, elle demeura exposée sur un grand échafaud drapé de velours blanc, au beau milieu de la cathédrale ; durant trois jours, des messes furent célébrées sans interruption par l’évêque et son clergé ; trois jours durant, les chants de Pâques entonnés par tout le peuple tassé dans les bas côtés de la basilique retentirent avec le tonnerre des orgues, et la princesse ne se réveilla pas.
Des pétales de roses s’amoncelaient, telle une neige montante, au pied de la haute estrade, l’orient des perles de ses colliers miroitait sur le blanc de son cou ; autour d’elle c’était la clarté de mille et mille cierges, autour d’elle des vapeurs d’encens déroulaient leurs spirales bleuâtres, et, lointaine, comme inaccessible et apparue en rêve derrière leurs brumes mouvantes, la princesse gisait immobile : elle dormait toujours au milieu des brocarts, des cires allumées, des psaumes et des fleurs.
Elle ne vivait ni ne mourait.
C’est alors que l’évêque Afranus eut une inspiration du ciel. Qui sait si le soleil, le grand air, la bise et la pluie, la force même des éléments ne feraient pas ce que l’Église et ses chants liturgiques n’avaient pu obtenir ? Il fit donc construire pour ce doux corps tombé en léthargie un étroit et long cercueil de verre aux huit angles ornés de lys d’argent ciselé ; on y coucha la princesse endormie sur un lit de soie capitonnée, et le vieux prélat décida que, tous les jours que Dieu ferait, on promènerait Bertrade à dos de brancardiers à travers les bourgs et les campagnes avec haltes dans toutes les chapelles et tous les couvents du royaume ; un long cortège de pénitents et de fidèles en prière suivrait toujours le corps royal, Dieu prendrait peut-être enfin en pitié leur douleur ; la nuit, la châsse voyageuse reposerait dans le choeur des églises ou dans la crypte des cloîtres.
Dernière édition par le Ven 25 Nov - 12:11, édité 1 fois | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Ven 25 Nov - 12:10 Ven 25 Nov - 12:10 | |
| II
Alors ce fut par le royaume attristé un défilé d’interminables processions. On ne rencontra plus désormais par les routes que diacres en surplis et moines en cagoules psalmodiant des proses de lamentations ; ce n’étaient partout à l’orée des champs, comme à l’entrée des bourgs, que prunelles ardentes et faces extatiques, que mains jointes et pieds nus : femmes du peuple, artisans, rustres et laboureurs accourus en grande ferveur sur le passage de la princesse.
Par les plaines jaunes de moissons, comme par les haies fleuries d’avril, de longues silhouettes encapuchonnées apparaissaient tout à coup aux carrefours ; de grandes bannières de soie molle sombraient, telles de hautes voilures, au-dessus des récoltes ; des odeurs de myrrhe et d’encens se mêlaient aux senteurs de la terre. C’était, au milieu des encensoirs et des cires flambants, la châsse royale qui passait.
Toute blême dans la pâleur de ses brocarts et de ses moires, les paupières closes sous sa couronne de roses de perles, on eût dit une immobile Notre-Dame des Larmes, toute de soie et de filigranes ; et les parois limpides de la bière hexagone luisaient au soleil d’août comme de l’eau gelée. En novembre, il arrivait que les cierges s’éteignaient brusquement sous la pluie, les hautes croix d’argent chancelaient aux mains engourdies des porteurs, la bise s’engouffrait aux bannières, et devant le blanc cercueil crépitant sous la grêle, femmes nobles et manants s’agenouillaient pêle-mêle dans la boue des ornières et, en toute saison, le glas pleurait sans trêve sur les campagnes hallucinées.
C’était, d’un bout de l’année à l’autre, une suite ininterrompue de lents et somptueux pèlerinages ; toutes les églises, tous les couvents du pays étaient visités. La châsse royale ne réintégrait la capitale du royaume que deux fois par an, la semaine avant Noël et celle d’avant Pâques, grandes fêtes de l’Église où une opinion accréditée dans le peuple voulait que l’évêque Afranus donnât la communion à la princesse enchantée. Il soutenait ainsi, disait-on, par la miraculeuse substance de l’hostie ce léthargique et doux cadavre, cet exsangue et royal corps de vierge qui ne pouvait ni revivre ni mourir ; mais c’étaient là rumeurs populaires. La Princesse sous Verre, c’est ainsi qu’on appelait maintenant Bertrade, demeurait bien exposée à la vénération des fidèles, en plein choeur de la cathédrale, du dimanche des Rameaux jusqu’au mardi de Pâques et toute la semaine qui précédait Noël, mais on n’avait jamais vu l’évêque s’approcher de l’auguste châsse. Une fois par an seulement, le dimanche des Rameaux, six Ursulines, choisies parmi les plus jeunes de tous les couvents du royaume, étaient admises à toucher le cercueil royal et à changer sur le front de la morte sa couronne de perles et de moelle de roseaux.
Les fêtes terminées, la princesse et son cortège reprenaient le cours de leurs pérégrinations sous le soleil et sous la pluie, et c’était déjà la cinquième année de ces pèlerinages inutiles. En dépit des prévisions de l’évêque, la Princesse sous Verre n’avait pas plus remué la soie raidie de ses paupières que le froid ivoire de ses belles mains ; le vieux roi son père, tombé dans une espèce de torpeur stupide, devenu presque indifférent de douleur, avait abandonné son camp des frontières pour se cloîtrer dans le château des Bois, le château bâti au milieu des marais, où s’était éteinte, il y avait plus de vingt ans, la princesse d’Occitanie, mère de Bertrade, et où Bertrade, sa petite rose de Noël, devait si singulièrement s’endormir seize années et six mois plus tard. Le vieux monarque vivait désormais là, dans la nuit des hautes pièces aux fenêtres murées, seul en face du passé surgissant quelquefois de l’eau morte des miroirs, sortant à peine de sa retraite pour assister, deux fois par an, dans la ville, à l’exposition de la Princesse sous Verre au beau milieu de la cathédrale.
De là, il rentrait dans son château, dans son oubli ; des ministres régnaient pour lui.
Quant au prince Otto, il avait, lui aussi, presque entièrement disparu. À la suite d’un bizarre accident, de l’incendie d’un de ses châteaux d’été, où les plus belles courtisanes du royaume avaient toutes péri d’une mort horrible, son humeur était encore devenue plus farouche ; et moitié par remords, moitié par terreur de la haine populaire qui l’accusait d’avoir mis le feu lui-même, il s’était retiré dans les forêts de l’Ouest, parmi les solitudes boisées de la frontière, celles-là même qu’avoisinent le nord de la Souabe et les marches de Bohême. L’incendie, qu’une odieuse rumeur l’accusait d’avoir allumé au cours d’une fête offerte au duc héritier de Livonie, et au milieu de laquelle les plus belles femmes de ce temps avaient trouvé la mort, avait achevé d’égarer sa raison. Réfugié au fond de bois impénétrables avec une poignée de mauvais garçons, il y menait, disait-on, la vie de chef de bande, celle en somme des hauts barons du siècle, détroussant le passant, tuant l’oiseau dans l’air, pillant le juif et le marchand, forçant la bête dans sa tanière et le manant en son taudis ; et tous les pauvres gens tremblaient devant le prince Noir devenu le prince Rouge.
Un dernier exploit d’Otto comblait la mesure.
Au cours d’une de ses expéditions à main armée, embuscade ou partie de chasse, on ne savait trop, puisqu’il était suivi de ses chiens, le prince s’était rencontré à la lisière d’un bois avec le lent cortège de cierges et de croix qui accompagnait la princesse. La vue des cires flambantes réveilla-t-elle en lui le souvenir de son crime ou le maléfice du Bohémien ne fut-il pas plutôt exaspéré par les chants liturgiques ? Mais un subit accès de fureur le saisit et, l’écume aux lèvres, vociférant des anathèmes, il fonça tout à coup, lui, sa meute et ses gens, sur la pieuse escorte, culbutant moines et moinillons, piétinant pêle-mêle sous les chevaux cabrés femmes et porteurs de cires, de christs et de bannières. Ce fut une panique atroce, une débandade épouvantable à travers la consternation des campagnes ; les brancardiers terrifiés abandonnèrent précipitamment la châsse de verre qui se brisa, et le corps délicat de Bertrade, à demi sorti de son cercueil, glissa hors de son lit de soie pâle dans la boue grasse du chemin. Il y demeura toute la nuit, exposé à la pluie de novembre ; on le retrouva le lendemain, au petit jour, au milieu des chandeliers d’argent et des longues bannières jetés par les fuyards au travers de la route, immobile et pâle sous ses brocarts flétris et les éclats poudreux de sa couronne de perles. Le prince Otto éperdu d’horreur avait fui devant son sacrilège ; le fragile et doux corps de la Princesse sous Verre était donc demeuré douze heures à l’abandon. Quand les gens du roi, prévenus en toute hâte, accoururent sur les lieux pour relever la châsse et ramener la princesse au palais, ils reculèrent tous épouvantés : deux rigoles de sang trempaient et raidissaient la moire de sa robe, ses bras fuselés, qui se croisaient, la veille encore, sur un lys de filigrane d’or, laissaient pendre maintenant deux informes moignons où du sang se caillait. En animaux féroces qu’étaient les chiens danois et les dogues à nez court du cruel prince Otto, cette meute digne de son maître s’était, dans cette chasse donnée à des prêtres, à des femmes et à des enfants, offert une curée que n’eût point désavouée le chasseur Noir, elle avait dévoré les mains de la princesse.
L’hallali valait la curée.
Et le sang coulait, tiède et rouge, en dépit des yeux clos et de la face blêmie : la princesse vivait toujours.
À cette nouvelle, une indignation souleva tout le royaume, le vieux roi sortit enfin de sa torpeur et décréta dans un édit la mise à prix de la tête du prince, l’évêque Afranus obtint du Pape un bref interdisant l’eau, le pain et le sel au sacrilège Otto et à ses compagnons. Des gibets se dressèrent à tous les carrefours : les complices du prince Noir, poursuivis et traqués, y balancèrent leurs cadavres ; seul, le prince Noir échappa, passé à temps à l’étranger, réfugié on ne sait dans quelle retraite, évanoui, à jamais disparu.
La Princesse sous Verre réintégra, pour n’en jamais sortir, l’étroit vaisseau de la cathédrale. Hissée très haut au-dessus du maître-autel, au pied même du grand Christ ouvrant ses deux paumes percées sur les stalles du choeur, elle demeura désormais offerte à la vénération des foules dans une châsse scellée à même la muraille, une châsse, cette fois, toute en cristal de roche aux angles enrichis d’anémones d’opales, et qui luisait, incendiée de reflets, avec des prismes d’arc-en-ciel au milieu des pierreries brasillantes de vitrail de deux grandes rosaces.
Les cierges brûlaient leur flamme au-dessous d’elle, au-dessous d’elle se balançait, tel un oiseau énorme, la grande lampe du choeur et, vertigineuse, lointaine, elle apparaissait comme un point de lumière aux yeux éblouis des fidèles, morte vivante retranchée de la vie et déjà de plain-pied avec l’éternité, déjà si près des nervures des voûtes, déjà si loin dans les hauteurs. On avait recouvert d’un drap d’or ses pauvres mains mutilées et, désormais cachée jusqu’au menton sous le somptueux linceul, on eût dit une vraie morte bien plus qu’une princesse endormie ; et les gens avaient peur quand durant les offices, leurs yeux venaient à rencontrer sa petite tête de cire posée sur les coussins, hors du splendide amas d’étoffes.
Les pieds troués du Christ semblaient pleurer sur elle le sang de leurs blessures ; depuis longtemps déjà le vieux roi était mort.
Dernière édition par le Ven 25 Nov - 12:12, édité 1 fois | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Ven 25 Nov - 12:11 Ven 25 Nov - 12:11 | |
| III
Et des années s’écoulèrent et d’autres rois moururent. Une autre dynastie régnait sur la Courlande, des collatéraux éloignés du feu roi, qui n’avaient jamais connu la princesse Bertrade et le farouche Otto, vagues étrangers pour lesquels la martyre royale, enfermée dans sa châsse aérienne, n’était qu’une étrangère, une vague héroïne de conte. Des gens très âgés se souvenaient bien d’avoir assisté dans leur enfance à des cérémonies étranges, mais les forfaits du prince Otto s’associaient malencontreusement à ces souvenirs, ils obsédaient la mémoire du peuple ; et la famille régnante, alors dans toute la gloire et l’insolent orgueil de la Courlande unie et pacifiée, découvrit un beau jour que cette morte, juchée au milieu des bannières du choeur, avait trop longtemps attristé de son spectre les hosannas de triomphes. Cette Princesse sous Verre enténébrait la cathédrale : on croyait toujours, sous cette châsse funèbre, assister à l’office des morts, et cette face de cadavre apparue dans le clair-obscur des voûtes changeait en De Profundis les plus beaux Te Deum ; et puis, du vivant du vieux roi, n’avait-elle pas assez longtemps épouvanté les villes et les campagnes par le sombre apparat de ses dolents cortèges, l’errante Princesse sous Verre toujours par voies et par chemins ! La Courlande hallucinée n’était pas, après soixante ans de repos, encore remise de ce cauchemar ; pourquoi éterniser à jamais dans l’esprit des foules l’abominable souvenir d’une cour de fous et de maniaques, de reines ensorcelées et de princes criminels ? La mémoire d’un règne aussi tragique ne pouvait que nuire à la prospérité des autres règnes, ce serait une délivrance pour tous le jour où ce cercueil enchanté ne serait plus là.
Ce que veut l’empereur, le Pape le bénit, ce que veut le roi, les prêtres l’encensent.
Une nuit, la châsse de cristal où reposait Bertrade fut descendue des voûtes. Pauvre Bertrade la pâle, l’évêque Afranus n’était plus là pour la défendre.
Il y a longtemps qu’il dormait, lui aussi, sous les dalles du choeur, en compagnie des autres prélats rangés, la crosse en main, sur de hauts sarcophages dans la crypte de la cathédrale. À la place même où la Princesse sous Verre étincelait, planante, au-dessus des fidèles, les armes de la famille régnante s’étalèrent entre les étendards et les trophées de guerre, et le peuple applaudit ce blason héraldique écrasant de l’or de son cimier le divin tabernacle et la prière des cierges.
Une chapelle latérale avait reçu la châsse de Bertrade. Elle y vieillit dans l’ombre, objet des dévotions de quelques pauvres vieilles femmes, des survivantes de l’ancien règne qui peu à peu ne vinrent plus. Sainte sans miracles qui ne guérissait ni les lépreux ni les paralytiques, elle tomba bientôt dans l’abandon ; les petits clercs chargés d’entretenir la lampe devant sa splendeur spectrale se firent, eux aussi, négligents : les parois de cristal devinrent poussiéreuses, les opales des angles se ternirent, des araignées y tendirent leurs toiles, et ce fut comme un second suaire filé autour de la Princesse sous Verre par le silence et par l’oubli.
Les moires et les soies qui la touchaient jaunirent, les fleurs de perles s’égrenèrent, et dans la moisissure et le délabrement de la pauvre chapelle une angoisse grandit autour de cette morte fantôme apparue, telle une poupée de cire, sous un linceul d’orfroi et des gazes raidies. Une longue ogive aux vitres dépolies versait en toute saison un morne jour d’hiver sur la nappe de l’autel et, posé à même le retable, le cercueil de verre y luisait tristement, tel un bloc de glace où se serait figé un cadavre.
On n’allumait jamais les cierges, jamais diacre n’y célébrait de messe et les dévotes attardées à quelque autel voisin redoutaient, une fois la nuit tombée, de passer devant la chapelle et à cause de cette morte et à cause de cette plaie sous ce suaire, qui peut-être saignait toujours.
Et comme de mauvais prêtres, pour complaire aux princes régnants, parlaient de sorcellerie et citaient des histoires de vampires retrouvés frais et gras dans leur fosse, les yeux clos comme ceux de la princesse et, comme elle, paraissant dormir, le haut clergé s’émut et résolut de dérober cette fille de roi aux soupçons populaires : il fallait rendre aussi et le plus tôt au culte la chapelle suspecte ; un scrupule pourtant arrêtait le chapitre : on ne pouvait sans sacrilège enterrer ce corps léthargique qui peut-être n’avait point cessé de vivre ; on s’arrêta à ce projet : déposer la châsse royale sur une barque et confier l’une et l’autre au courant du fleuve, à la merci de Dieu.
La châsse fut transportée par une nuit sans lune sur la berge, au milieu des oseraies qui s’étendent derrière la cathédrale ; la princesse y fut furtivement embarquée à bord d’un bateau plat sous les yeux de l’évêque, assisté de trois diacres. Des feuillages de houx et des branches de pins formaient un lit de verdure autour d’elle, car Noël était proche et le houx et le pin chassent le Mauvais Esprit ; puis l’évêque donna une dernière absoute, on poussa la barque dans le courant du fleuve et la morte exilée se mit doucement à descendre.
Ils la suivirent longtemps des yeux et, quand ils la crurent enfin hors de la ville, ils rentrèrent précipitamment dans l’église et y célébrèrent une messe basse qui mit en repos leur conscience.
Au loin, très loin, vers le château des Bois, sous le vent froid de la nuit, la Princesse sous Verre descendait les eaux lentes qui serpentent et se traînent au milieu des marais.
Elle vogua ainsi durant des lieues et des lieues entre les berges désolées par l’hiver : les roseaux séchés tintaient mélancoliquement sous la bise aigre, de gros nuages gris fuyaient éperdus dans le ciel, et, les nuits d’étoiles, de grandes ombres noires s’enlevaient lourdement au-dessus des étangs ; elles tournoyaient un instant avec des cris plaintifs à l’entour de la barque et puis fuyaient au loin comme en grande détresse, et rien n’était plus triste au-dessus des eaux pâles que ces appels d’oiseaux sauvages ; et la Princesse sous Verre continuait de glisser sur le fleuve, indolente, entre les rives engourdies par le gel ; et personne n’accourait pour saluer son passage, elle, dont les pèlerinages pieux avaient jadis soulevé tout le pays. L’épais brouillard des soirs et le givre des aubes la baignaient tour à tour, et sous la pluie, le vent, le verglas et la neige, la châsse de cristal, reluisante et lavée, avait l’éclat des anciens jours.
L’antique château des Bois de sa première enfance la vit rôder ainsi, toute une longue journée, au milieu des marais qui l’entourent, mais le vieux gardien, qui seul eût pu la reconnaître, était devenu aveugle ; on n’ouvrait plus à cause de ses yeux perdus les épais volets des croisées et la Princesse sous Verre passa sans un salut à l’ombre de ses tours.
Et les rives recommencèrent plus mornes, plus plates et plus glacées à mesure qu’elles s’enfonçaient vers le Nord ; c’étaient des étendues de boue durcie où d’innombrables tiges de roseaux ondulaient à perte de vue, et pas un filet de fumée ne montait vers le ciel. Elle parvint ainsi l’avant-veille de Noël dans une solitude éclatante et figée, toute de tourbières et d’étangs et là, parmi les oseraies brunes et de vastes champs de flèches d’eau jaunies, les eaux du fleuve commencèrent à se prendre, et la barque s’arrêta à cause des glaçons.
Une infinie détresse pesait sur ce paysage dont l’air semblait gelé et muet ; on était à la veille de Noël et pas un son de cloche vibrait sur les plaines et pourtant les toits et le clocher, qui pointaient à quelques pas de là au-dessus d’un rideau de roseaux secs et blêmes, étaient bien les toits et le clocher d’un couvent.
Étrange moustier, en vérité, ce couvent d’hommes engourdi par l’hiver dans ce morne et dolent paysage, et dont pas une sonnerie, pas un chant liturgique ne réveillait la torpeur à la veille de la plus grande fête de l’Église, à la veille de Noël.
Étrange couvent ! Depuis plus de quarante années déjà on n’y sonnait plus les cloches, on n’y chantait plus de psaumes et, comme tombé en léthargie, il se taisait au milieu du silence assoupi des marais. Telle était la formelle volonté de son prieur, un plus étrange vieillard à la barbe toute blanche et qui bientôt allait mourir.
Une sombre légende voulait qu’en d’autres temps, du vivant du précédent abbé, un proscrit, un inconnu à face de bandit fût venu demander asile dans ce monastère alors tout sonore et d’oraisons et d’angélus ; l’homme accueilli y avait fait grande pénitence, y édifiant frères et novices par l’austérité de ses jeûnes et l’ardeur de ses flagellations. À son lit de mort, le précédent abbé l’avait désigné pour son successeur : le vote des moines avait ratifié ce choix. Mais depuis lors, au choeur comme dans le clocher, toute voix s’était tue, la prose des cantiques se lisait à voix basse, et, depuis quarante ans, toute cloche était muette. Le nouvel abbé avait imposé le silence à la communauté, la règle déjà étroite avait sous lui redoublé de rigueur ; et dans l’observance exacte de la règle, dans le jeûne, dans la veille, la prière et la pauvreté, le prieur actuel, un grand pécheur, disaient les uns, un grand seigneur, disaient les autres, attendait pour mourir que la voix des cloches immobiles éclatât dans l’espace, car, le jour où sonneraient les cloches, luirait pour lui l’heure de miséricorde et son passé lui serait pardonné.
Cette nuit-là, sous la neige qui commençait à voleter par les préaux, les moines quittèrent un à un leurs cellules et se rendirent au choeur pour la messe de minuit ; c’était désormais une messe basse sans hymnes d’allégresse, sans chants de bienvenue. Le prieur y descendit le dernier, si cassé, si vieux, si chargé de chagrins, de remords et d’années qu’il fallait deux moines pour le soutenir ; il y entra, les yeux éteints, la face si hâve et si tirée sous les flots de sa longue barbe qu’on eût dit un cadavre aux mains de deux frères ; mais à peine eurent-ils paru tous les trois sous le porche qu’une claire et joyeuse sonnerie les salua dans les airs : toutes les cloches en branle carillonnaient dans le clocher, et tous les moines sentirent une surprise exquise se fondre dans leur coeur.
Ils sortirent tous en grande hâte hors de l’enceinte du cloître et se répandirent en joie sur la berge pour voir quel ange du Seigneur était descendu dans la tour ; le prieur ébloui les suivait, appuyé sur ses aides, les deux mains en avant, tâtonnantes. Les cloches sonnaient seules à toute volée, mais au milieu du fleuve, arrêtée par les glaces, la Princesse sous Verre rayonnait étincelante d’une surnaturelle clarté ; autour d’elle la neige floconnait douce et lente, et, sous le translucide reliquaire de cristal, son front transparaissait couronné de roses de Noël, non plus factices, mais fraîches écloses.
Son corps bienheureux avait rejeté son linceul, et, le sourire aux lèvres, ses longues paupières closes, elle dormait, tenant entre ses mains redevenues pures et belles, ses pauvres mains jadis dévorées par les chiens, une énorme gerbe de roses rouges, du rouge même du sang de ses plaies.
Et le prieur, étant tombé à genoux, comprit que Bertrade était morte, qu’elle avait pardonné, et que lui aussi allait mourir.
À lui, son cruel bourreau, à lui, le farouche Otto, le sinistre prince Noir devenu le prince Rouge, aujourd’hui moine et repentant, elle venait en signe d’absolution apporter la gerbe éclatante et vermeille, les roses symboliques écloses de ses plaies, les fleurs de son sang.
Il essaya de faire amener la barque au rivage, mais la glace se rompait sous les pas des frères lais, les harpons tombaient à l’eau, et il fut impossible de l’atteindre. Toute la nuit, le prince Otto la passa en prière, à genoux sur la berge, sous la neige tombante ; on avait allumé de grands feux ; les moines rangés autour chantaient tour à tour l’Hosanna et le Miserere ; sur le couvent en fête les cloches sonnaient toujours.
Aux premières lueurs de l’aube, les glaces se fondirent, la barque merveilleuse descendit les eaux lentes, puis disparut à un tournant du fleuve.
Paru dans la Revue illustrée en 1895.
Repris dans : Jean LORRAIN, Princesses d’ivoire et d’ivresse,
coll. « Les maîtres de l’étrange et de la peur »,
Union Générale d’Éditions, 1980 | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Ven 25 Nov - 12:21 Ven 25 Nov - 12:21 | |
| Maintenant, une légende typiquement québecoise 
La chasse-galerie
Une contribution de M. Jean-Yves Dupuis,
mise en forme HTML du texte original
La légende qui suit a déjà été publiée dans La Patrie, il y a quelque dix ans, et en anglais dans le Century Magazine de New York, du mois d'août 1892, avec illustrations par Henri Julien. Elle a paru aussi dans À la Mémoire de Alphonse Lusignan/ Hommage de ses amis et confrères, Montréal, Desaulniers et Leblanc, 1892, pp. 289-312. On voit que cela ne date pas d'hier. Le récit lui-même est basé sur une croyance populaire qui remonte à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du Nord-Ouest. Les gens de chantier ont continué la tradition, et c'est surtout dans les paroisses riveraines du Saint-Laurent que l'on connaît les légendes de la chasse-galerie. J'ai rencontré plus d'un vieux voyageur qui affirmait avoir vu voguer dans l'air des canots d'écorce remplis de possédés s'en allant voir leurs blondes, sous l'égide de Belzébuth. Si j'ai été forcé de me servir d'expressions plus ou moins académiques, on voudra bien se rappeler que je mets en scène des hommes au langage aussi rude que leur difficile métier. H.B.
I
Pour lors que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire, dans le fin fil; mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats-huants font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps.
Pas un homme ne fit mine de sortir; au contraire tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook finissait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstance.
On était à la veille du jour de l'an 1858, en pleine forêt vierge, dans les chantiers des Ross, en haut de la Gatineau. La saison avait été dure et la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane.
Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pattes et des glissantes pour le repas du lendemain. La mélasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tire qui devait terminer la soirée.
Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien, et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane, où un feu pétillant de pin résineux jetait, cependant, par intervalles, des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant par des effets merveilleux de clair-obscur, les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois.
Joe le cook était un petit homme assez mal fait, que l'on appelait assez généralement le bossu, sans qu'il s'en formalisât, et qui faisait chantier depuis au moins 40 ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits.
II
— Je vous disais donc, continua-t-il, que si j'ai été un peu tough dans ma jeunesse, je n'entends plus risée sur les choses de la religion. J'vas à confesse régulièrement tous les ans, et ce que je vais vous raconter là se passait aux jours de ma jeunesse quand je ne craignais ni Dieu ni diable. C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an, il y a de cela 34 ou 35 ans. Réunis avec tous mes camarades autour de la cambuse, nous prenions un petit coup; mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches, et dans ces temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui, et il n'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poings et des tirages de tignasse. La jamaïque était bonne, — pas meilleure que ce soir, — mais elle était bougrement bonne, je vous le parsouête. J'en avais bien lampé une douzaine de petits gobelets, pour ma part, et sur les onze heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait et je me laissai tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme en attendant l'heure de sauter à pieds joints par-dessus la tête d'un quart de lard, de la vieille année dans la nouvelle, comme nous allons le faire ce soir sur l'heure de minuit, avant d'aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin.
Je dormais donc depuis assez longtemps lorsque je me sentis secouer rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durant, qui me dit:
— Joe! minuit vient de sonner et tu es en retard pour le saut du quart. Les camarades sont partis pour faire leur tournée et moi je m'en vais à Lavaltrie voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi?
À Lavaltrie! lui répondis-je, es-tu fou? nous en sommes à plus de cent lieues et d'ailleurs aurais-tu deux mois pour faire le voyage, qu'il n'y a pas de chemin de sortie dans la neige. Et puis, le travail du lendemain du jour de l'an?
— Animal! répondit mon homme, il ne s'agit pas de cela. Nous ferons le voyage en canot d'écorce, à l'aviron, et demain matin à six heures nous serons de retour au chantier.
Je comprenais.
Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde, au village. C'était raide! Il était bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque, mais risquer de vendre mon âme au diable, ça me surpassait.
— Cré poule mouillée! continua Baptiste, tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il s'agit d'aller à Lavaltrie et de revenir dans six heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on voyage au moins 50 lieues à l'heure lorsqu'on sait manier l'aviron comme nous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet, et de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'oeil où l'on va et ne pas prendre de boisson en route. J'ai déjà fait le voyage cinq fois et tu vois bien qu'il ne m'est jamais arrivé malheur. Allons, mon vieux, prends ton courage à deux mains et si le coeur t'en dit, dans deux heures de temps, nous serons à Lavaltrie. Pense à la petite Liza Guimbette et au plaisir de l'embrasser. Nous sommes déjà sept pour faire le voyage mais il faut être deux, quatre, six ou huit et tu seras le huitième.
— Oui! tout cela est très bien, mais il faut faire un serment au diable, et c'est un animal qui n'entend pas à rire lorsqu'on s'engage à lui.
— Une simple formalité, mon Joe. Il s'agit simplement de ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son aviron. Un homme n'est pas un enfant, que diable! Viens! viens! nos camarades nous attendent dehors et le grand canot de la drave est tout prêt pour le voyage.
Je me laissai entraîner hors de la cabane où je vis en effet six de nos hommes qui nous attendaient, l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige dans une clairière et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat bord, attendant le signal du départ. J'avoue que j'étais un peu troublé, mais Baptiste qui passait dans le chantier, pour n'être pas allé à confesse depuis sept ans, ne me laissa pas le temps de me débrouiller. Il était à l'arrière, debout, et d'une voix vibrante il nous dit:
— Répétez avec moi!
Et nous répétâmes:
Satan! roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes, si d'ici à six heures nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition tu nous transporteras, à travers les airs, au lieu où nous voulons aller et tu nous ramèneras de même au chantier!
Dernière édition par le Ven 25 Nov - 12:24, édité 1 fois | |
|   | | Zazou
Admin


Nombre de messages : 24033
Localisation : Québec, Qc
Emploi : Technicienne en réseaux informatiques, ex-recetionniste et ex-horticultrice
Le nom et l'espèce de mes animaux : Scarlett (chatte burmilla tiffany) et Léopold (betta)
Date d'inscription : 12/10/2005
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  Ven 25 Nov - 12:21 Ven 25 Nov - 12:21 | |
| III
Acabris! Acabras! Acabram!
Fais-nous voyager par-dessus les montagnes!
À peine avions-nous prononcé les dernières paroles que nous sentîmes le canot s'élever dans l'air à une hauteur de cinq ou six cents pieds. Il me semblait que j'étais léger comme une plume et, au commandement de Baptiste, nous commençâmes à nager comme des possédés que nous étions. Aux premiers coups d'aviron le canot s'élança dans l'air comme une flèche, et c'est le cas de le dire, le diable nous emportait. Ça nous en coupait le respire et le poil en frisait sur nos bonnets de carcajou.
Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart d'heure, environ, nous naviguâmes au-dessus de la forêt sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pins noirs. Il faisait une nuit superbe et la lune, dans son plein, illuminait le firmament comme un beau soleil du midi. Il faisait un froid du tonnerre et nos moustaches étaient couvertes de givre, mais nous étions cependant tous en nage. Ça se comprend aisément puisque c'était le diable qui nous menait et je vous assure que ce n'était pas sur le train de la Blanche. Nous aperçûmes bientôt une éclaircie, c'était la Gatineau dont la surface glacée et polie étincelait au-dessous de nous comme un immense miroir. Puis, p'tit à p'tit nous aperçûmes des lumières dans les maisons d'habitants; puis des clochers d'églises qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats, quand ils font l'exercice sur le champ de Mars de Montréal. On passait ces clochers aussi vite qu'on passe les poteaux de télégraphe, quand on voyage en chemin de fer. Et nous filions toujours comme tous les diables, passant par-dessus les villages, les forêts, les rivières et laissant derrière nous comme une traînée d'étincelles. C'est Baptiste, le possédé, qui gouvernait, car il connaissait la route et nous arrivâmes bientôt à la rivière des Outaouais qui nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des Deux-Montagnes.
— Attendez un peu, cria Baptiste. Nous allons raser Montréal et nous allons effrayer les coureux qui sont encore dehors à c'te heure cite. Toi, Joe! là, en avant, éclaircis-toi le gosier et chante-nous une chanson sur l'aviron.
En effet, nous apercevions déjà les mille lumières de la grande ville, et Baptiste, d'un coup d'aviron, nous fit descendre à peu près au niveau des tours de Notre-Dame. J'enlevai ma chique pour ne pas l'avaler, et j'entonnai à tue-tête cette chanson de circonstance que tous les canotiers répétèrent en choeur:
Mon père n'avait fille que moi,
Canot d'écorce qui va voler,
Et dessus la mer il m'envoie:
Canot d'écorce qui vole, qui vole,
Canot d'écorce qui va voler!
Et dessus la mer il m'envoie,
Canot d'écorce qui va voler,
Le marinier qui me menait:
Canot d'écorce qui vole, qui vole,
Canot d'écorce qui va voler!
Le marinier qui me menait,
Canot d'écorce qui va voler,
Me dit ma belle embrassez-moi:
Canot d'écorce qui vole, qui vole,
Canot d'écorce qui va voler!
Me dit, ma belle, embrassez-moi,
Canot d'écorce qui va voler,
Non, non, monsieur, je ne saurais:
Canot d'écorce qui vole, qui vole,
Canot d'écorce qui va voler!
Non, non, monsieur, je ne saurais,
Canot d'écorce qui va voler,
Car si mon papa le savait:
Canot d'écorce qui vole, qui vole,
Canot d'écorce qui va voler!
Car si mon papa le savait,
Canot d'écorce qui va voler,
Ah c'est bien sûr qu'il me battrait:
Canot d'écorce qui vole, qui vole,
Canot d'écorce qui va voler!
Bien qu'il fût près de deux heures du matin, nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour nous voir passer, mais nous filions si vite qu'en un clin d'œil nous avions dépassé Montréal et ses faubourgs, et alors je commençai à compter les clochers: la Longue-Pointe, la Pointe-aux-Trembles, Repentigny, Saint-Sulpice, et enfin les deux flèches argentées de Lavaltrie qui dominaient le vert sommet des grands pins du domaine.
— Attention! vous autres, nous cria Baptiste. Nous allons atterrir à l'entrée du bois, dans le champ de mon parrain, Jean-Jean Gabriel, et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans quelque fricot ou quelque danse du voisinage.
Qui fut dit fut fait, et cinq minutes plus tard notre canot reposait dans un banc de neige à l'entrée du bois de Jean-Jean Gabriel; et nous partîmes tous les huit à la file pour nous rendre au village. Ce n'était pas une mince besogne car il n'y avait pas de chemin battu et nous avions de la neige jusqu'au califourchon. Baptiste qui était plus effronté que les autres s'en alla frapper à la porte de la maison de son parrain où l'on apercevait encore de la lumière, mais il n'y trouva qu'une fille engagère qui lui annonça que les vieilles gens étaient à un snaque chez le père Robillard, mais que les farauds et les filles de la paroisse étaient presque tous rendus chez Batissette Augé, à la Petite-Misère, en bas de Contrecoeur, de l'autre côté du fleuve, où il y avait un rigodon du jour de l'an.
— Allons au rigodon, chez Batissette Augé, nous dit Baptiste, on est certain d'y rencontrer nos blondes.
— Allons chez Batissette! Et nous retournâmes au canot, tout en nous mettant mutuellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles et de prendre un coup de trop, car il fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant six heures du matin, sans quoi nous étions flambés comme des carcajous, et le diable nous emportait au fin fond des enfers.
Acabris! Acabras! Acabram!
Fais-nous voyager par-dessus les montagnes!
cria de nouveau Baptiste. Et nous voilà repartis pour la Petite-Misère, en naviguant en l'air comme des renégats que nous étions tous. En deux tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve et nous étions rendus chez Batissette Augé dont la maison était tout illuminée. On entendait vaguement, au dehors, les sons du violon et les éclats de rire des danseurs dont on voyait les ombres se trémousser, à travers les vitres couvertes de givre. Nous cachâmes notre canot derrière les tas de bourdillons qui bordaient la rive, car la glace avait refoulé, cette année-là.
— Maintenant, nous répéta Baptiste, pas de bêtises, les amis, et attention à vos paroles. Dansons comme des perdus, mais pas un seul verre de Molson, ni de jamaïque, vous m'entendez! Et au premier signe, suivez-moi tous, car il faudra repartir sans attirer l'attention. Et nous allâmes frapper à la porte.
IV
Le père Batissette vint ouvrir lui-même et nous fûmes reçus à bras ouverts par les invités que nous connaissions presque tous. Nous fûmes d'abord assaillis de questions:
— D'où venez-vous?
— Je vous croyais dans les chantiers!
— Vous arrivez bien tard!
— Venez prendre une larme!
Ce fut encore Baptiste qui nous tira d'affaire en prenant la parole:
— D'abord, laissez-nous nous décapoter et puis ensuite laissez-nous danser. Nous sommes venus exprès pour ça. Demain matin, je répondrai à toutes vos questions et nous vous raconterons tout ce que vous voudrez.
Pour moi j'avais déjà reluqué Liza Guimbette qui était faraudée par le p'tit Boisjoli de Lanoraie.
Je m'approchai d'elle pour la saluer et pour lui demander l'avantage de la prochaine qui était un reel à quatre. Elle accepta avec un sourire qui me fit oublier que j'avais risqué le salut de mon âme pour avoir le plaisir de me trémousser et de battre des ailes de pigeon en sa compagnie. Pendant deux heures de temps, une danse n'attendait pas l'autre et ce n'est pas pour me vanter si je vous dis que, dans ce temps-là, il n'y avait pas mon pareil à dix lieues à la ronde pour la gigue simple ou la voleuse. Mes camarades, de leur côté, s'amusaient comme des lurons, et tout ce que je puis vous dire, c'est que les garçons d'habitants étaient fatigués de nous autres, lorsque quatre heures sonnèrent à la pendule. J'avais cru apercevoir Baptiste Durand qui s'approchait du buffet où les hommes prenaient des nippes de whisky blanc, de temps en temps, mais j'étais tellement occupé avec ma partenaire que je n'y portai pas beaucoup d'attention. Mais maintenant que l'heure de remonter en canot était arrivée, je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de trop et je fus obligé d'aller le prendre par le bras pour le faire sortir avec moi, en faisant signe aux autres de se préparer à nous suivre sans attirer l'attention des danseurs. Nous sortîmes donc les uns après les autres sans faire semblant de rien et cinq minutes plus tard, nous étions remontés en canot, après avoir quitté le bal comme des sauvages, sans dire bonjour à personne; pas même à Liza que j'avais invitée pour danser un foin. J'ai toujours pensé que c'était cela qui l'avait décidée à me trigauder (1) et à épouser le petit Boisjoli sans même m'inviter à ses noces, la bougresse. Mais pour revenir à notre canot, je vous avoue que nous étions rudement embêtés de voir que Baptiste Durand avait bu un coup, car c'était lui qui nous gouvernait et nous n'avions juste que le temps de revenir au chantier pour six heures du matin, avant le réveil des hommes qui ne travaillaient pas le jour du jour de l'an. La lune était disparue et il ne faisait plus aussi clair qu'auparavant, et ce n'est pas sans crainte que je pris ma position à l'avant du canot, bien décidé à avoir l'œil sur la route que nous allions suivre. Avant de nous enlever dans les airs, je me retournai et je dis à Baptiste:
— Attention! là, mon vieux. Pique tout droit sur la montagne de Montréal, aussitôt que tu pourras l'apercevoir.
— Je connais mon affaire, répliqua Baptiste, et mêle-toi des tiennes! Et avant que j'aie eu le temps de répliquer:
Acabris! Acabras! Acabram!
Fais-nous voyager par-dessus les montagnes!
V
Et nous voilà repartis à toute vitesse. Mais il devint aussitôt évident que notre pilote n'avait plus la main aussi sûre, car le canot décrivait des zigzags inquiétants. Nous ne passâmes pas à cent pieds du clocher de Contrecoeur et au lieu de nous diriger à l'ouest, vers Montréal, Baptiste nous fit prendre les bordées vers la rivière Richelieu. Quelques instants plus tard, nous passâmes par-dessus la montagne de Beloeil et il ne s'en manqua pas de dix pieds que l'avant du canot n'allât se briser sur la grande croix de tempérance que l'évêque de Québec avait plantée là.
— À droite! Baptiste! à droite! mon vieux, car tu vas nous envoyer chez le diable, si tu ne gouvernes pas mieux que ça!
Et Baptiste fit instinctivement tourner le canot vers la droite en mettant le cap sur la montagne de Montréal que nous apercevions déjà dans le lointain. J'avoue que la peur commençait à me tortiller car si Baptiste continuait à nous conduire de travers, nous étions flambés comme des gorets qu'on grille après la boucherie. Et je vous assure que la dégringolade ne se fit pas attendre, car au moment où nous passions au-dessus de Montréal, Baptiste nous fit prendre une sheer (2) et avant d'avoir eu le temps de m'y préparer, le canot s'enfonçait dans un banc de neige, dans une éclaircie, sur le flanc de la montagne. Heureusement que c'était dans la neige molle, que personne n'attrapât de mal et que le canot ne fût pas brisé. Mais à peine étions-nous sortis de la neige que voilà Baptiste qui commence à sacrer comme un possédé et qui déclare qu'avant de repartir pour la Gatineau, il veut descendre en ville prendre un verre. J'essayai de raisonner avec lui, mais allez donc faire entendre raison à un ivrogne qui veut se mouiller la luette. Alors, rendus à bout de patience, et plutôt que de laisser nos âmes au diable qui se léchait déjà les babines en nous voyant dans l'embarras, je dis un mot à mes autres compagnons qui avaient aussi peur que moi, et nous nous jetons tous sur Baptiste que nous terrassons, sans lui faire de mal, et que nous plaçons ensuite au fond du canot, — après l'avoir ligoté comme un bout de saucisse et lui avoir mis un bâillon pour l'empêcher de prononcer des paroles dangereuses, lorsque nous serions en l'air. Et:
Acabris! Acabras! Acabram!
nous voilà repartis sur un train de tous les diables car nous n'avions plus qu'une heure pour nous rendre au chantier de la Gatineau. C'est moi qui gouvernais, cette fois-là, et je vous assure que j'avais l'œil ouvert et le bras solide. Nous remontâmes la rivière Outaouais comme une poussière jusqu'à la Pointe à Gatineau et de là nous piquâmes au nord vers le chantier. Nous n'en étions plus qu'à quelques lieues, quand voilà-t-il pas cet animal de Baptiste qui se détortille de la corde avec laquelle nous l'avions ficelé, qui s'arrache son bâillon et qui se lève tout droit, dans le canot, en lâchant un sacre qui me fit frémir jusque dans la pointe des cheveux. Impossible de lutter contre lui dans le canot sans courir le risque de tomber d'une hauteur de deux ou trois cents pieds, et l'animal gesticulait comme un perdu en nous menaçant tous de son aviron qu'il avait saisi et qu'il faisait tournoyer sur nos têtes en faisant le moulinet comme un Irlandais avec son shilelagh (3). La position était terrible, comme vous le comprenez bien. Heureusement que nous arrivions, mais j'étais tellement excité, que par une fausse manoeuvre que je fis pour éviter l'aviron de Baptiste, le canot heurta la tête d'un gros pin et que nous voilà tous précipités en bas, dégringolant de branche en branche comme des perdrix que l'on tue dans les épinettes. Je ne sais pas combien je mis de temps à descendre jusqu'en bas, car je perdis connaissance avant d'arriver, et mon dernier souvenir était comme celui d'un homme qui rêve qu'il tombe dans un puits qui n'a pas de fond.
VI
Vers les huit heures du matin, je m'éveillai dans mon lit dans la cabane, où nous avaient transporté des bûcherons qui nous avaient trouvés sans connaissance, enfoncés jusqu'au cou, dans un banc de neige du voisinage. Heureusement que personne ne s'était cassé les reins mais je n'ai pas besoin de vous dire que j'avais les côtes sur le long comme un homme qui a couché sur les ravalements pendant toute une semaine, sans parler d'une blackeye (4) et de deux ou trois déchirures sur les mains et dans la figure. Enfin, le principal, c'est que le diable ne nous avait pas tous emportés et je n'ai pas besoin de vous dire que je ne m'empressai pas de démentir ceux qui prétendirent qu'ils m'avaient trouvé, avec Baptiste et les six autres, tous saouls comme des grives, et en train de cuver notre jamaïque dans un banc de neige des environs. C'était déjà pas si beau d'avoir risqué de vendre son âme au diable, pour s'en vanter parmi les camarades; et ce n'est que bien des années plus tard que je racontai l'histoire telle qu'elle m'était arrivée.
Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c'est que ce n'est pas si drôle qu'on le pense que d'aller voir sa blonde en canot d'écorce, en plein cœur d'hiver, en courant la chasse-galerie; surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m'en croyez, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos p'tits coeurs, sans courir le risque de voyager aux dépens du diable.
Et Joe le cook plongea sa micouane (5) dans la mélasse bouillonnante aux reflets dorés, et déclara que la tire était cuite à point et qu'il n'y avait plus qu'à l'étirer.
(1) Trigauder: ne pas agir franchement.
(2) Prendre une sheer: glisser et tomber.
(3) Shilelagh: Bâton.
(4) Blackeye: Œil au beurre noir.
(5) Micouane: Cuillère de bois. | |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver Sujet: Re: Contes et poêmes sur le thème de l'hiver  | |
| |
|   | | | | Contes et poêmes sur le thème de l'hiver |  |
|
Sujets similaires |  |
|
Sujets similaires |  |
| |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |